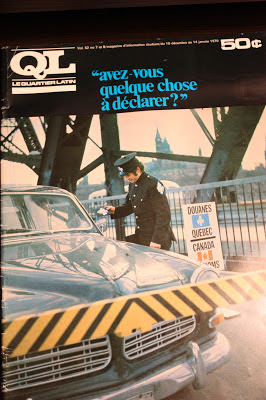Depuis 50 ans, d'abord comme étudiant, puis comme journaliste, mon principal outil - je dirais presque mon seul outil - a toujours été un clavier. D'abord ceux des bonnes vieilles machines à écrire Underwood, puis brièvement ceux des machines à écrire électriques que je détestais, puis, à partir du milieu des années 1980, les claviers des ordinateurs. Les marteaux, les scies, les perceuses, les jeux de clés nécessitent des compétences que je n'ai pas...
Étant nul (voire une menace...) en bricolage, je suis totalement allergique à des magasins comme IKEA où tout, absolument tout, requiert de l'assemblage. L'enfer, IKEA, c'est pareil... J'ai par contre une fascination pour les magasins Canadian Tire, qui ressemblent à des espèces de capharnaüms où s'empilent, rayon après rayon, les objets et outils les plus divers... pour l'auto, l'électricité, la plomberie, certains mobiliers, la chasse, la pêche, et bien plus. Un monde que je trouve à la fois étrange et attrayant. Une grande surface du 21e siècle avec l'âme d'un ancien magasin général des temps passés...
À Gatineau, du moins dans mon secteur de Gatineau, celui qui s'appelait Gatineau avant que les fusions des 40 dernières années imposent l'appellation Gatineau à un méga-territoire, le stationnement du Canadian Tire est toujours bondé. J'ai parfois l'impression que toute la ville se donne rendez-vous dans les allées de cette super quincaillerie. Les gens y semblent à l'aise, comme s'ils étaient chez eux. Ils cherchent, ils trouvent. C'est du moins l'impression que j'ai. Moi, par contre, entre la porte d'entrée et la porte de sortie, je ne sais jamais dans lequel des 80 et quelque rayons me rendre... j'ai besoin d'information... et donc de trouver un employé pour me renseigner... et c'est là que le fun commence...
Hier soir, avec mon épouse, je suis allé au Canadian Tire pour acheter une structure métallique de rangement (à tablettes), que nous n'avions pas trouvée la veille dans l'immense (plus gros qu'immense) IKEA d'Ottawa où des gens peuvent errer à la recherche des portes de sortie pendant des jours... Un endroit horrifiant... Alors nous voilà au Canadian Tire dans l'espoir de repartir avec notre structure de rangement... Poussant notre panier, on arpente l'ensemble du magasin en vain... On a bien repéré deux allées d'articles de rangement mais rien qui ressemble à ce dont on a besoin...
Et nous voilà tout à coup devant un comptoir dans le secteur de l'automobile où trois préposés semblent attendre qu'un client vienne les solliciter... Une aubaine : trois employés disponibles au même endroit ! Alors je pose la question : où dois-je me rendre pour voir les structures de rangement, s'il y en a dans le magasin ? Ils ne savent pas. Ce n'est pas leur département. Allez au comptoir d'information, dit l'un d'eux, dans l'allée 26. On vous renseignera... On avait déjà vu ce comptoir dans notre premier kilomètre de marche dans le magasin... On avait cru qu'il s'agissait du rayon de la peinture... et il n'y avait personne...
Alors, hop, au comptoir de l'allée 26... Les chiffres des rangées sont identifiés en gros... N'y manque que le 26 bien sûr mais entre 24 et 28, on ne peut guère se tromper... Il n'y a personne... même pas de clients qui attendent. Quelques minutes plus tard, un employé au regard fatigué se pointe avec un client en laisse, et on en profite pour lui demander où aller... Près de la caisse 1, dit-il, les structures sont toutes là... et on finit par en trouver une qui fait notre affaire (diable, il y aura de l'assemblage requis...). Mais il y a une note sous la structure : pour les articles de cette rangée, veuillez demander de l'aide...
Demander de l'aide, mais à qui? Je regarde autour et vois le comptoir « Service à la clientèle » où, par miracle, une employée est libre... Vite, avant qu'elle se sauve ou qu'un autre client la subtilise, je lui parle. À qui on demande de l'aide pour les structures de rangement? Ce n'est pas ici, dit-elle, (et sûrement pas au comptoir de l'automobile), rendez-vous au comptoir d'information de l'allée 26... Merci, on sait où c'est, on y est déjà passé deux fois...
Retour au comptoir de la rangée 26, où il n'y toujours personne devant les étagères de gallons de peinture... Après quelques minutes, une employée s'amène pour nous informer qu'elle est « un peu » occupée avec d'autres clients mais qu'elle finira par revenir... Mon épouse commence à se décourager. Peut-être pourrait-on commander en ligne et faire livrer ? Attendons encore un peu... L'employé au regard fatigué est de retour, encore avec un client, et nous voyant, crie: Christian, es-tu occupé? Ce Christian mystérieux n'a pas répondu... et on ne l'a pas vu non plus...
Finalement, la fille « un peu » occupée revient et elle l'est toujours, mais pas pour longtemps, assure-t-elle. Et de fait, elle revient vite. On lui pose la question de tantôt, et elle se rend avec nous près de la caisse 1, dans l'allée des structures de rangement. Faut-il faire livrer (c'est 45 $...) ou cela vient-il en boîte... Elle doit vérifier et part avec nous à la recherche d'un ordi dans une des allées (un de ces vieux ordis du 20e siècle où l'écriture s'affiche en vert lumineux sur fond noir...). Oui, il en reste une seule dans l'entrepôt !
Elle doit la trouver, et mesurer pour voir si ça « fitte » dans le coffre de l'auto... Mais cette fois, nous sommes tombés sur la bonne ! Pas question de refiler le dossier une nouvelle fois au comptoir de l'allée 26 (où elle ne travaille pas d'ailleurs, elle dépannait...). Jusque là, nous nous sentions un peu comme Astérix et Obélix dans la maison de fous (Les douze travaux d'Astérix), nous avions l'impression de tourner en rond... et d'être dans un magasin où les employés disponibles ne sont jamais ceux dont vous avez besoin...
Cueillant au passage un ruban à mesurer, la jeune fille file à l'entrepôt, mesure le tout, et revient environ 5 minutes plus tard avec la structure en boîte sur un chariot. Pouvons-nous emprunter le chariot jusqu'à l'auto? C'est plutôt pesant... Pas besoin, dit-elle, je vais vous accompagner au stationnement : « Je suis jeune et forte », lance-t-elle avec le sourire. Oui, mais il faut passer par les caisses où il y a toujours des files d'attente. Parfait, dit-elle, je reste avec vous ! Incroyable ! Ça, c'est du service ! Sortez les médailles d'honneur. On a trouvé l'employée Canadian Tire du mois !
Elle a attendu aux caisses, poussé le chariot jusque dans le stationnement, m"a aidé (sans effort apparent) à placer la lourde boîte dans le coffre et est repartie avec le sourire... En fin de compte, vive les Canadian Tire !
Nous ne sommes pas cependant à la fin de l'histoire... J'ai dans le garage deux boîtes... une d'IKEA, l'autre de Canadian Tire, qui contiennent un meuble et une structure nécessitant de l'assemblage... Les choses risquent maintenant de se gâter...
samedi 27 juillet 2013
mercredi 24 juillet 2013
Team Canada ou Équipe Québec?
Je ne mêle pas souvent de sports parce que je n'ai pas la compétence requise pour confronter les experts (les vrais et les soi-disant) qui passent année après année à décortiquer les exploits des uns et des autres. Je ne pratique qu'un sport - le golf - et mes exploits se résument à un trou d'un coup dans les années 1970 au Dunnderosa (Chelsea, Québec) dont seul mon défunt beau-père pourrait témoigner. Pour le reste, je suis plutôt nul. Mais depuis ma tendre enfance, j'aime le hockey, même si j'ai renié mon ancienne équipe - Les Canadiens - quand ils ont mis Lafleur à la porte en 1984... Faire ça à mon idole...
Je me souviens quand j'étais petit, à 8 ou 9 ans, nous venions d'acheter notre premier téléviseur et mes parents nous laissaient regarder un peu de hockey le samedi soir. Nos joueurs préférés s'appelaient Maurice Richard, son jeune frère Henri, Jean Béliveau, Bernard Geoffrion, Émile Bouchard, Jacques Plante, et bien d'autres. On nous pardonnera d'avoir eu pour héros nos meilleurs joueurs canadiens-français, et d'avoir considéré les Canadiens comme notre équipe parce que plusieurs de ses meilleurs joueurs parlaient notre langue. Plus tard, dans les années 1970, Lafleur avait pris la relève avec brio...
Cette époque est malheureusement révolue, et aujourd'hui, on compte sur les doigts d'une main les joueurs francophones de l'équipe montréalaise... Les vedettes canadiennes-françaises ou québécoises sont éparpillées avec quelques concentrations ça et là... Enfin... que cela serve d'introduction à ce dont je veux parler dans ce texte. Ce matin, en lisant les pages sportives du Droit, je notais que le gardien de Pittsburgh Marc-André Fleury se disait déçu de ne pas avoir été invité au camp d'Équipe Canada en vue des Olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, en Russie.
Alors j'ai consulté la liste des joueurs invités, publiés la veille dans Le Droit. Sur près de 50 invitations, seulement six - Corey Crawford, Roberto Luongo, Patrice Bergeron, Kristopher Letang, Marc-Édouard Vlasic et Martin St-Louis - étaient adressées à des joueurs du Québec. S'y ajoutaient quelques francophones d'autres provinces, y compris Claude Giroux et Dan Boyle. C'est peu mais, direz-vous, qu'en sais-tu, toi l'incompétent en sports? Et vous auriez raison. Il y aura toujours des tas d'« experts » pour démontrer que Carey Price est meilleur que Marc-André Fleury, ou que Joe Thornton constitue un meilleur atout que Vincent Lecavalier.
Inutile alors d'évoluer sur ce plan, où il n'y a jamais de vainqueur à l'exception de ceux qui prennent les vraies décisions finales. Mais je suis mécontent, comme bien d'autres francophones sans doute. Sans preuve possible, je reste convaincu que « nos » vedettes de hockey (dans d'autres sports aussi) sont trop souvent sous-représentées quand vient le temps de former un « Team Canada » pour affronter la planète. Oh, il y a toujours quelques joueurs de notre coin de pays, soit parce que ne pas les inclure serait indécent, soit parce que ce serait gênant d'expliquer leur absence, mais on s'en tient habituellement au strict minimum... Vrai, pas vrai? Je vous dit ce que je ressens comme amateur depuis des décennies...
J'ai passé en revue la liste complète des joueurs de la LNH, des espoirs repêchés récemment aux vétérans, et j'ai dénombré plus de 100 joueurs du Québec, couvrant toutes les positions sur la glace. Certains sont déjà de grandes vedettes, d'autres demeurent pour le moment inconnus, certains ne sont que de bons « plombiers ». Certains n'ont que 19 ans, d'autres ont dépassé la mi-trentaine. C'est bien suffisant, en tout cas, pour former une équipe qui pourrait concurrencer sur le plan mondial.
Et il est grand temps qu'on y songe sérieusement. Si le reste du pays et les directions pan-canadiennes du hockey et d'autres sports avaient vraiment voulu incarner la dualité du pays, le chiâlage aurait cessé depuis longtemps chez les francophones. Assez, c'est assez ! Qu'ils la fassent, « leur » équipe, à leur goût... Et que nous formions la nôtre... Qui sait, nous assisterions peut-être à une finale Équipe Québec/Team Canada. Et si nous perdons, eh bien, ce sera sur la glace, fair and square, pas dans les officines de bureaux où nous n'avons et n'aurons jamais le dernier mot...
Je me souviens quand j'étais petit, à 8 ou 9 ans, nous venions d'acheter notre premier téléviseur et mes parents nous laissaient regarder un peu de hockey le samedi soir. Nos joueurs préférés s'appelaient Maurice Richard, son jeune frère Henri, Jean Béliveau, Bernard Geoffrion, Émile Bouchard, Jacques Plante, et bien d'autres. On nous pardonnera d'avoir eu pour héros nos meilleurs joueurs canadiens-français, et d'avoir considéré les Canadiens comme notre équipe parce que plusieurs de ses meilleurs joueurs parlaient notre langue. Plus tard, dans les années 1970, Lafleur avait pris la relève avec brio...
Cette époque est malheureusement révolue, et aujourd'hui, on compte sur les doigts d'une main les joueurs francophones de l'équipe montréalaise... Les vedettes canadiennes-françaises ou québécoises sont éparpillées avec quelques concentrations ça et là... Enfin... que cela serve d'introduction à ce dont je veux parler dans ce texte. Ce matin, en lisant les pages sportives du Droit, je notais que le gardien de Pittsburgh Marc-André Fleury se disait déçu de ne pas avoir été invité au camp d'Équipe Canada en vue des Olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, en Russie.
Alors j'ai consulté la liste des joueurs invités, publiés la veille dans Le Droit. Sur près de 50 invitations, seulement six - Corey Crawford, Roberto Luongo, Patrice Bergeron, Kristopher Letang, Marc-Édouard Vlasic et Martin St-Louis - étaient adressées à des joueurs du Québec. S'y ajoutaient quelques francophones d'autres provinces, y compris Claude Giroux et Dan Boyle. C'est peu mais, direz-vous, qu'en sais-tu, toi l'incompétent en sports? Et vous auriez raison. Il y aura toujours des tas d'« experts » pour démontrer que Carey Price est meilleur que Marc-André Fleury, ou que Joe Thornton constitue un meilleur atout que Vincent Lecavalier.
Inutile alors d'évoluer sur ce plan, où il n'y a jamais de vainqueur à l'exception de ceux qui prennent les vraies décisions finales. Mais je suis mécontent, comme bien d'autres francophones sans doute. Sans preuve possible, je reste convaincu que « nos » vedettes de hockey (dans d'autres sports aussi) sont trop souvent sous-représentées quand vient le temps de former un « Team Canada » pour affronter la planète. Oh, il y a toujours quelques joueurs de notre coin de pays, soit parce que ne pas les inclure serait indécent, soit parce que ce serait gênant d'expliquer leur absence, mais on s'en tient habituellement au strict minimum... Vrai, pas vrai? Je vous dit ce que je ressens comme amateur depuis des décennies...
J'ai passé en revue la liste complète des joueurs de la LNH, des espoirs repêchés récemment aux vétérans, et j'ai dénombré plus de 100 joueurs du Québec, couvrant toutes les positions sur la glace. Certains sont déjà de grandes vedettes, d'autres demeurent pour le moment inconnus, certains ne sont que de bons « plombiers ». Certains n'ont que 19 ans, d'autres ont dépassé la mi-trentaine. C'est bien suffisant, en tout cas, pour former une équipe qui pourrait concurrencer sur le plan mondial.
Et il est grand temps qu'on y songe sérieusement. Si le reste du pays et les directions pan-canadiennes du hockey et d'autres sports avaient vraiment voulu incarner la dualité du pays, le chiâlage aurait cessé depuis longtemps chez les francophones. Assez, c'est assez ! Qu'ils la fassent, « leur » équipe, à leur goût... Et que nous formions la nôtre... Qui sait, nous assisterions peut-être à une finale Équipe Québec/Team Canada. Et si nous perdons, eh bien, ce sera sur la glace, fair and square, pas dans les officines de bureaux où nous n'avons et n'aurons jamais le dernier mot...
vendredi 19 juillet 2013
Hydro-Québec 101
Avant de parler d'Hydro-Québec, un petit détour vers mes souvenirs d'enfance (on fait souvent ça quand on a plus de 65 ans...). Je suis assez vieux pour me souvenir de l'époque où les téléphones n'avaient pas de cadran. On prenait le récepteur et on attendait. Vite, une téléphoniste de Bell (presque toujours anglophone, Ottawa oblige) faisait entendre sa voix nasillarde : « Number please... ». On donnait le numéro désiré et la téléphoniste assurait la connexion. La morale de cette histoire, c'est qu'un humain était toujours au bout du fil quand on décrochait le récepteur du téléphone.
Aujourd'hui, c'est une autre affaire. Pour moi qui n'aime pas parler à des boîtes vocales, l'époque est désolante! Des répondeurs partout, tout le temps! Parfois pour de bonnes raisons, parfois simplement pour filtrer les appels et éviter de répondre aux « indésirables »... et de plus en plus souvent, ces jours-ci, pour éviter de payer des salaires à des employés qu'on remplace par des machines parlantes. Ces dernières sont entièrement programmables, et jamais syndiquées. Enfin, revenons à Hydro-Québec...
La nuit dernière (de jeudi à vendredi), de gros orages ont balayé l'Outaouais, et notamment là où se situe notre petit chalet non climatisé, à la frontière de la municipalité de La Pêche et de la grande région du Pontiac - aux abords du Lac Sinclair. Ce qui devait arriver arriva, pour la deuxième fois en trois jours : une panne d'électricité. D'abord, ça clignote, puis tout s'éteint, puis les lumières se rallument... Le même scénario, une deuxième fois, alors que je m'installais, vers 4 heures du matin, pour regarder en direct l'Omnium britannique de golf. Puis vers 4 h 15, pouf ! Plus rien, et ça reste noir...
Un peu bizarre comme panne, puisque l'orage était déjà terminé depuis un bout de temps... mais enfin. L'important, c'est d'avertir tout de suite Hydro-Québec. À l'heure qu'il est, je suis peut-être le premier à m'en être aperçu... Vite, je compose le numéro que je connais par coeur, à force de l'avoir utilisé souvent... 1-800-790-2424... Et la voix informatisée se fait entendre, avec ses options habituelles. Si la panne affecte la résidence où vous êtes, faites le « 1 ». Et on appuie sur le « 1 ». La Voix féminine d'Hydro poursuit : Dites votre code postal...
Une colle, je ne l'attendais pas celle-là. Je n'ai aucune idée du code postal du chalet... Je raccroche en me demandant si je vais réveiller mon épouse avant le lever du soleil pour lui demander le code postal du chalet.... Réflexion faite, non, pas tout de suite... On reprend à zéro. 1-800-790-2424. Quand elle me relance la question sur le code postal, je garde le silence. Mauvaise réponse. Je n'ai rien entendu, dit la machine qui a l'oreille fine. Si vous ne savez pas le code postal, dites : code postal inconnu. Et je m'exécute.
Pour vous situer, poursuit-elle, donnez-moi un autre numéro de téléphone à proximité de la maison où sévit la panne. Elle devient indiscrète. Pourquoi lui donnerais-je le numéro de ma voisine, qui est aussi la soeur de mon épouse? Enfin, comme la panne l'affecte elle aussi, ce serait lui rendre service que d'utiliser son numéro de téléphone comme repère pour la Voix d'Hydro. Et de m'exécuter de nouveau, ce qui semble satisfaire la personne virtuelle au bout du fil.
Là, la Voix me demande de donner mon adresse (enfin... il me semble que c'est la première question qu'une machine sensée aurait posée...). Après l'avoir répétée correctement, elle me demande de confirmer que ce que je viens d'entendre est conforme à ce que j'avais dit. Confirmé, dis-je et la voix informatique de s'éclipser au profit d'une seconde voix informatisée, nettement mieux informée que la première, qui dit : « La panne dans votre secteur est causée par un bris d'équipement. L'électricité sera de retour vers 8 heures. »
Dans notre coin quand même pas très isolé de l'Outaouais (où il n'y cependant pas de connexion cellulaire, à une soixantaine de km à peine du centre-ville de Gatineau et d'Ottawa), quatre heures pour réparer une panne, c'est un peu long, mais c'est acceptable. Donc on attend. Huit heures approche, le soleil monte vite dans le ciel, la chaleur et l'humidité sont déjà accablantes, et les ventilateurs sont fermés parce qu'il n'y a pas de courant. Mon épouse suggère une nouvelle vérification auprès d'Hydro-Québec. Cette fois, j'ai le code postal, donc une étape de moins...
La 2e Voix m'informe que le bris d'équipement ne sera pas réparé à 8 heures... C'est 11 heures maintenant ! Pourquoi? Impossible de savoir, il n'y a personne au bout du fil pour expliquer, juste la maudite machine qui répète les mêmes options et qui comprend seulement les mêmes réponses... N'essayez pas de torpiller le scénario du répondeur en composant le zéro, ce qui court-circuite parfois les cascades de messages et vous mène vers une voix véritablement humaine... Avec Hydro, ça ne marche pas. Et n'essayez pas de trouver un autre numéro de téléphone, du moins pas dans le bottin téléphonique de la région de La Pêche - Chelsea. Le nom Hydro-Québec n'y figure même pas. En tout cas, j'ai cherché et ne l'ai pas trouvé...
Alors je prends mon mal en patience. Je téléphonerais bien au siège social d'Hydro à Montréal ou au bureau régional de l'Outaouais, si je le pouvais, mais je n'ai pas accès à l'Internet sans électricité... Bientôt onze heures... Pas de douche, pas d'eau (la pompe est électrique...), pas d'Omnium britannique à la télévision... Ça va mal... À 11 h, toujours pas de jus, un autre appel 1-800-790-2424 à la Voix 1 et la Voix 2 qui me dit, exactement sur le même ton que la fois précédente, un ton neutre, sans sourire, que la panne sera réparée à midi. Une autre heure et personne pour me dire pourquoi... Ils se moquent de leurs clients, ces gens !
Midi passe et toujours rien. Pas d'eau, télé morte, chaleur suffocante... Inutile de vociférer au téléphone, il n'y a que les Voix programmées. Je sais que les équipes d'Hydro sont sur la route et font leur possible, mais à titre de client payant et de citoyen (Hydro étant une entreprise publique, elle est à mon service), j'estime avoir droit à des explications d'un porte-parole humain à qui je peux poser des questions... Inutile d'insister... La Voix me dit cette fois que ce sera... 13 heures ! Ça ne va pas non?
Assez! Ce petit jeu pourrait continuer longtemps et on n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe vraiment. On vide le frigo, on refait les valises, et on rentre en ville dans notre auto climatisée vers notre maison climatisée. Un chalet sans eau et sans électricité quand on ne s'y attend pas, c'est pas le fun... Ma belle-soeur nous a informés en soirée que le courant avait finalement été rétabli vers 17 heures... et qu'il n'y avait toujours pas d'eau (la panne aurait torpillé la pompe électrique?). C'aurait été plus facile de trouver un plombier si la panne avait été réparée en matinée... Le vendredi soir, ce n'est pas évident...
Alors avis à Hydro-Québec. Je suis un client insatisfait. Pas de vos réparateurs, qui font sans doute leur possible. Je suis insatisfait d'une direction d'entreprise publique qui est incapable de prévoir un contact avec de vrais humains quand les pannes se prolongent indûment... Si ce n'était que de moi, je ferais arrêter quelques dirigeants d'Hydro-Québec et je les obligerais à écouter leurs répondeurs téléphoniques pendant quelques semaines sans arrêt... Les choses changeraient...
Quant à moi, après quatre ou cinq « échanges » avec les Voix du répondeur d'Hydro au 1-800-790-2424, je commençais à m'ennuyer des téléphonistes de mon enfance, même si elles étaient pour la plupart unilingues anglaises...
Aujourd'hui, c'est une autre affaire. Pour moi qui n'aime pas parler à des boîtes vocales, l'époque est désolante! Des répondeurs partout, tout le temps! Parfois pour de bonnes raisons, parfois simplement pour filtrer les appels et éviter de répondre aux « indésirables »... et de plus en plus souvent, ces jours-ci, pour éviter de payer des salaires à des employés qu'on remplace par des machines parlantes. Ces dernières sont entièrement programmables, et jamais syndiquées. Enfin, revenons à Hydro-Québec...
La nuit dernière (de jeudi à vendredi), de gros orages ont balayé l'Outaouais, et notamment là où se situe notre petit chalet non climatisé, à la frontière de la municipalité de La Pêche et de la grande région du Pontiac - aux abords du Lac Sinclair. Ce qui devait arriver arriva, pour la deuxième fois en trois jours : une panne d'électricité. D'abord, ça clignote, puis tout s'éteint, puis les lumières se rallument... Le même scénario, une deuxième fois, alors que je m'installais, vers 4 heures du matin, pour regarder en direct l'Omnium britannique de golf. Puis vers 4 h 15, pouf ! Plus rien, et ça reste noir...
Un peu bizarre comme panne, puisque l'orage était déjà terminé depuis un bout de temps... mais enfin. L'important, c'est d'avertir tout de suite Hydro-Québec. À l'heure qu'il est, je suis peut-être le premier à m'en être aperçu... Vite, je compose le numéro que je connais par coeur, à force de l'avoir utilisé souvent... 1-800-790-2424... Et la voix informatisée se fait entendre, avec ses options habituelles. Si la panne affecte la résidence où vous êtes, faites le « 1 ». Et on appuie sur le « 1 ». La Voix féminine d'Hydro poursuit : Dites votre code postal...
Une colle, je ne l'attendais pas celle-là. Je n'ai aucune idée du code postal du chalet... Je raccroche en me demandant si je vais réveiller mon épouse avant le lever du soleil pour lui demander le code postal du chalet.... Réflexion faite, non, pas tout de suite... On reprend à zéro. 1-800-790-2424. Quand elle me relance la question sur le code postal, je garde le silence. Mauvaise réponse. Je n'ai rien entendu, dit la machine qui a l'oreille fine. Si vous ne savez pas le code postal, dites : code postal inconnu. Et je m'exécute.
Pour vous situer, poursuit-elle, donnez-moi un autre numéro de téléphone à proximité de la maison où sévit la panne. Elle devient indiscrète. Pourquoi lui donnerais-je le numéro de ma voisine, qui est aussi la soeur de mon épouse? Enfin, comme la panne l'affecte elle aussi, ce serait lui rendre service que d'utiliser son numéro de téléphone comme repère pour la Voix d'Hydro. Et de m'exécuter de nouveau, ce qui semble satisfaire la personne virtuelle au bout du fil.
Là, la Voix me demande de donner mon adresse (enfin... il me semble que c'est la première question qu'une machine sensée aurait posée...). Après l'avoir répétée correctement, elle me demande de confirmer que ce que je viens d'entendre est conforme à ce que j'avais dit. Confirmé, dis-je et la voix informatique de s'éclipser au profit d'une seconde voix informatisée, nettement mieux informée que la première, qui dit : « La panne dans votre secteur est causée par un bris d'équipement. L'électricité sera de retour vers 8 heures. »
Dans notre coin quand même pas très isolé de l'Outaouais (où il n'y cependant pas de connexion cellulaire, à une soixantaine de km à peine du centre-ville de Gatineau et d'Ottawa), quatre heures pour réparer une panne, c'est un peu long, mais c'est acceptable. Donc on attend. Huit heures approche, le soleil monte vite dans le ciel, la chaleur et l'humidité sont déjà accablantes, et les ventilateurs sont fermés parce qu'il n'y a pas de courant. Mon épouse suggère une nouvelle vérification auprès d'Hydro-Québec. Cette fois, j'ai le code postal, donc une étape de moins...
La 2e Voix m'informe que le bris d'équipement ne sera pas réparé à 8 heures... C'est 11 heures maintenant ! Pourquoi? Impossible de savoir, il n'y a personne au bout du fil pour expliquer, juste la maudite machine qui répète les mêmes options et qui comprend seulement les mêmes réponses... N'essayez pas de torpiller le scénario du répondeur en composant le zéro, ce qui court-circuite parfois les cascades de messages et vous mène vers une voix véritablement humaine... Avec Hydro, ça ne marche pas. Et n'essayez pas de trouver un autre numéro de téléphone, du moins pas dans le bottin téléphonique de la région de La Pêche - Chelsea. Le nom Hydro-Québec n'y figure même pas. En tout cas, j'ai cherché et ne l'ai pas trouvé...
Alors je prends mon mal en patience. Je téléphonerais bien au siège social d'Hydro à Montréal ou au bureau régional de l'Outaouais, si je le pouvais, mais je n'ai pas accès à l'Internet sans électricité... Bientôt onze heures... Pas de douche, pas d'eau (la pompe est électrique...), pas d'Omnium britannique à la télévision... Ça va mal... À 11 h, toujours pas de jus, un autre appel 1-800-790-2424 à la Voix 1 et la Voix 2 qui me dit, exactement sur le même ton que la fois précédente, un ton neutre, sans sourire, que la panne sera réparée à midi. Une autre heure et personne pour me dire pourquoi... Ils se moquent de leurs clients, ces gens !
Midi passe et toujours rien. Pas d'eau, télé morte, chaleur suffocante... Inutile de vociférer au téléphone, il n'y a que les Voix programmées. Je sais que les équipes d'Hydro sont sur la route et font leur possible, mais à titre de client payant et de citoyen (Hydro étant une entreprise publique, elle est à mon service), j'estime avoir droit à des explications d'un porte-parole humain à qui je peux poser des questions... Inutile d'insister... La Voix me dit cette fois que ce sera... 13 heures ! Ça ne va pas non?
Assez! Ce petit jeu pourrait continuer longtemps et on n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe vraiment. On vide le frigo, on refait les valises, et on rentre en ville dans notre auto climatisée vers notre maison climatisée. Un chalet sans eau et sans électricité quand on ne s'y attend pas, c'est pas le fun... Ma belle-soeur nous a informés en soirée que le courant avait finalement été rétabli vers 17 heures... et qu'il n'y avait toujours pas d'eau (la panne aurait torpillé la pompe électrique?). C'aurait été plus facile de trouver un plombier si la panne avait été réparée en matinée... Le vendredi soir, ce n'est pas évident...
Alors avis à Hydro-Québec. Je suis un client insatisfait. Pas de vos réparateurs, qui font sans doute leur possible. Je suis insatisfait d'une direction d'entreprise publique qui est incapable de prévoir un contact avec de vrais humains quand les pannes se prolongent indûment... Si ce n'était que de moi, je ferais arrêter quelques dirigeants d'Hydro-Québec et je les obligerais à écouter leurs répondeurs téléphoniques pendant quelques semaines sans arrêt... Les choses changeraient...
Quant à moi, après quatre ou cinq « échanges » avec les Voix du répondeur d'Hydro au 1-800-790-2424, je commençais à m'ennuyer des téléphonistes de mon enfance, même si elles étaient pour la plupart unilingues anglaises...
lundi 15 juillet 2013
Y'a de ces jours...
Y'a de ces jours... Hier, dimanche, 14 juillet (parenthèse - Vive la France !), c'en était un. Pas que je me plaigne, au contraire, des chaleurs de juillet, on en a eu trop peu de belles journées, en 2013... Mais enfin, c'est dimanche matin, Ginette (mon épouse) revient aujourd'hui d'un séjour d'une semaine à Orlando avec ma fille Véronique et son conjoint Nicolas et leurs deux enfants, Sophie et Cédric... et je veux, bien sûr, que tout soit propre...
Or, dehors, ce qui me sert de gazon (c'est vert et entre le trèfle en fleurs et les autres plantes il y a de l'herbe) a beaucoup grandi avec un arrosage généreux de Dame Nature (pourquoi c'est une femme?) et de mon système d'arrosage programmé pour mouiller le terrain entre 3 et 5 heures du matin les mardi, jeudi et samedi... Je me dis qu'il faudrait sortir la tondeuse... Et puis, je zieute l'auto et de toute évidence, elle pourrait être plus propre... et c'est sans compter la poussière et les brins de gazon et de saletés éparpillés sur les tapis de la voiture (que je ne vois pas de l'extérieur mais que l'oeil de faucon de mon épouse ne manquera pas de noter). Il faudrait donc aussi laver l'auto...
Je mets le nez dehors vers 7 h 30, après déjeuner, et il fait déjà chaud. Un coup d'oeil au thermomètre... déjà près de 26 et avec l'humidex, probablement plus de 30 degrés... et ça grimpe vite... Si je dois «travailler» dehors, il faudra le faire vite... Pas question de rôtir sous la chaleur et l'humidité en milieu de journée... Alors un peu avant 8 heures, espérant ne pas réveiller les voisins, je sors la tondeuse et m'attaque d'un pas vigoureux à la végétation en pleine croissance... Il n'a fallu qu'une quinzaine de minutes pour que je sois trempe « en lavette » sous un soleil déjà puissant...
Après avoir terminé la « pelouse » devant la maison, il restait la cour arrière... Je regarde ma montre... Non, remettons ça à demain matin, même heure... Au premier coup d'oeil, Ginette ne verra pas la cour, en arrivant de l'aéroport. Et il me reste l'auto à laver... encore au soleil...
À l'abordage. Un bon coup de «Shop Vac» à l'intérieur (où il fait déjà 40 degrés...). Vite une limonade avant de déshydrater... Puis c'est le temps d'un bon frottage au Hertel pour enlever la fine couche de poussière qui apparaît constamment de je ne sais trop où. Il est près de 9 heures et le mercure a sûrement grimpé d'un autre 3 ou 4 degrés... Dégoulinant de sueur (ce serait sans doute moins pire si je perdais une quinzaine de livres...), je me dis qu'il n'est plus question de laver l'extérieur de l'auto... d'autant plus que j'ai trouvé dans la voiture un coupon-rabais de 5$ sur un lavage chez Ultramar...
Sauvé ! L'Ultramar n'est qu'à deux ou trois minutes... Sur place, je présente mon coupon... et je vois apparaître le prix à l'écran de la caisse : $9 et quelques sous... Je remarque au commis que c'est un peu cher pour un lavage qui m'avait coûté, l'hiver dernier, environ 9$ sans coupon... Ah non, dit-il, c'est le lavage «suprême» que vous offre le coupon... avec cire et tout et tout... Mais je n'en veux pas, du lavage suprême... Coupon à la poubelle, lavage ordinaire. Ciel, c'est plus de 10 $... le prix a augmenté...
Enfin... l'important, c'est de ne plus avoir à suer au gros soleil... Petite attente en file en écoutant les tounes habituelles dimanche matin à la radio... puis c'est au tour du lave-auto de faire ce pour quoi je l'ai payé chèrement... Et voilà.... savon, jets d'eau, rinçage... c'est fait. Fier de moi, j'arrive à la maison et inspecte l'extérieur du char... Quelque chose ne va pas... Les portes sont pourtant censées être luisantes de propreté... Je passe mes doigts sur la porte arrière côté conducteur... et mes doigts sont noirs... Et c'est comme ça sur toutes les portes. Le maudit char est encore sale !!! Vraiment sale !!!
En maudit contre Ultramar (mais à quoi ça servirait d'aller piquer une colère au pauvre petit commis de la station d'essence qui ne m'a rien fait...) mais aussi contre moi-même pour avoir choisi la voie de la paresse, il ne restait qu'une chose à faire. Remplir le seau d'eau et de savon, sortir le boyau d'arrosage et affronter de nouveau les 30 degrés avec humidex de trente et quelque pour «vraiment» laver l'auto...
Je remets mes vieux souliers qui ont servi à tondre le gazon, un peu plus tôt, et je mets le pied dans l'auto pour m'assurer que les vitres sont bien fermées... laissant des tas de brins d'herbe sur mon tapis tout propre... Et me voilà penché pour les cueillir un par un... pas question de ressortir le Shop Vac... Mea culpa. Y'a des jours comme ça...
Mais soyez averti : le lave-auto Ultramar de la montée Paiement, angle Nobert, c'est de la marde...
Or, dehors, ce qui me sert de gazon (c'est vert et entre le trèfle en fleurs et les autres plantes il y a de l'herbe) a beaucoup grandi avec un arrosage généreux de Dame Nature (pourquoi c'est une femme?) et de mon système d'arrosage programmé pour mouiller le terrain entre 3 et 5 heures du matin les mardi, jeudi et samedi... Je me dis qu'il faudrait sortir la tondeuse... Et puis, je zieute l'auto et de toute évidence, elle pourrait être plus propre... et c'est sans compter la poussière et les brins de gazon et de saletés éparpillés sur les tapis de la voiture (que je ne vois pas de l'extérieur mais que l'oeil de faucon de mon épouse ne manquera pas de noter). Il faudrait donc aussi laver l'auto...
Je mets le nez dehors vers 7 h 30, après déjeuner, et il fait déjà chaud. Un coup d'oeil au thermomètre... déjà près de 26 et avec l'humidex, probablement plus de 30 degrés... et ça grimpe vite... Si je dois «travailler» dehors, il faudra le faire vite... Pas question de rôtir sous la chaleur et l'humidité en milieu de journée... Alors un peu avant 8 heures, espérant ne pas réveiller les voisins, je sors la tondeuse et m'attaque d'un pas vigoureux à la végétation en pleine croissance... Il n'a fallu qu'une quinzaine de minutes pour que je sois trempe « en lavette » sous un soleil déjà puissant...
Après avoir terminé la « pelouse » devant la maison, il restait la cour arrière... Je regarde ma montre... Non, remettons ça à demain matin, même heure... Au premier coup d'oeil, Ginette ne verra pas la cour, en arrivant de l'aéroport. Et il me reste l'auto à laver... encore au soleil...
À l'abordage. Un bon coup de «Shop Vac» à l'intérieur (où il fait déjà 40 degrés...). Vite une limonade avant de déshydrater... Puis c'est le temps d'un bon frottage au Hertel pour enlever la fine couche de poussière qui apparaît constamment de je ne sais trop où. Il est près de 9 heures et le mercure a sûrement grimpé d'un autre 3 ou 4 degrés... Dégoulinant de sueur (ce serait sans doute moins pire si je perdais une quinzaine de livres...), je me dis qu'il n'est plus question de laver l'extérieur de l'auto... d'autant plus que j'ai trouvé dans la voiture un coupon-rabais de 5$ sur un lavage chez Ultramar...
Sauvé ! L'Ultramar n'est qu'à deux ou trois minutes... Sur place, je présente mon coupon... et je vois apparaître le prix à l'écran de la caisse : $9 et quelques sous... Je remarque au commis que c'est un peu cher pour un lavage qui m'avait coûté, l'hiver dernier, environ 9$ sans coupon... Ah non, dit-il, c'est le lavage «suprême» que vous offre le coupon... avec cire et tout et tout... Mais je n'en veux pas, du lavage suprême... Coupon à la poubelle, lavage ordinaire. Ciel, c'est plus de 10 $... le prix a augmenté...
Enfin... l'important, c'est de ne plus avoir à suer au gros soleil... Petite attente en file en écoutant les tounes habituelles dimanche matin à la radio... puis c'est au tour du lave-auto de faire ce pour quoi je l'ai payé chèrement... Et voilà.... savon, jets d'eau, rinçage... c'est fait. Fier de moi, j'arrive à la maison et inspecte l'extérieur du char... Quelque chose ne va pas... Les portes sont pourtant censées être luisantes de propreté... Je passe mes doigts sur la porte arrière côté conducteur... et mes doigts sont noirs... Et c'est comme ça sur toutes les portes. Le maudit char est encore sale !!! Vraiment sale !!!
En maudit contre Ultramar (mais à quoi ça servirait d'aller piquer une colère au pauvre petit commis de la station d'essence qui ne m'a rien fait...) mais aussi contre moi-même pour avoir choisi la voie de la paresse, il ne restait qu'une chose à faire. Remplir le seau d'eau et de savon, sortir le boyau d'arrosage et affronter de nouveau les 30 degrés avec humidex de trente et quelque pour «vraiment» laver l'auto...
Je remets mes vieux souliers qui ont servi à tondre le gazon, un peu plus tôt, et je mets le pied dans l'auto pour m'assurer que les vitres sont bien fermées... laissant des tas de brins d'herbe sur mon tapis tout propre... Et me voilà penché pour les cueillir un par un... pas question de ressortir le Shop Vac... Mea culpa. Y'a des jours comme ça...
Mais soyez averti : le lave-auto Ultramar de la montée Paiement, angle Nobert, c'est de la marde...
samedi 13 juillet 2013
Quand les chandelles nous rassemblent...
En partie parce que le drame de Lac-Mégantic me touche profondément, mais aussi sans doute en partie parce que je suis journaliste de métier, je me suis rendu hier soir à la veillée de solidarité annoncée au parc Jacques-Cartier, sur les rives de l'Outaouais, au coeur du centre-ville de Gatineau. Je n'ai pas été déçu.
Personne ne semblait vraiment avoir « organisé » l'affaire. L'invitation avait tout simplement été lancée dans les médias et plus d'une centaine de personnes y ont répondu. Des jeunes, des vieux, de gens de tous les milieux, ayant en commun cet élan de solidarité pour les familles éprouvées de Lac-Mégantic... et ces chandelles et lampions déposés en cercle un peu avant le coucher du soleil.
L'ambiance était au recueillement. Oh, il y a bien eu quelques allocutions et témoignages, dont celui du maire Marc Bureau qui s'était joint à sa marmaille, mais c'était sans micro et amplification. Il fallait tendre l'oreille pour saisir ces paroles prononcées en douceur. Il n'y avait, pour le reste, que le bourdonnement sourd des conservations... et la musique d'un jeune violoniste venu exprimer à sa façon les émotions ressenties devant tant de vies perdues.
Les participants à cette vigile, pour la plupart, ne se connaissaient pas, mais en de tels moments, les Québécois redeviennent tous un peu cousins, cousines. J'ai en mémoire ma seule visite aux Îles-de-la-Madeleine, en 2002. Nous étions attablés à un restaurant et nous avons amorcé une conversation avec les gens de la table voisine, de parfaits étrangers... En quelques minutes, tous se parlaient d'un bord à l'autre du resto. Un tel venait de Mauricie, l'autre de l'Abitibi, nous de l'Outaouais, certains du Saguenay ou de l'Estrie... en un instant la « famille » s'était reconstituée.
Hier soir, c'était un peu ça. On entendait ça et là les gens parler de leur vie ou de leurs visites à Lac Mégantic (il y avait une dizaine de Méganticois là), de l'horreur de perdre un proche, du souvenir ineffaçable des images de l'explosion, des responsabilités de la compagnie ferroviaire. Des inconnus qui échangeaient comme s'ils s'étaient toujours connus. Méganticois, Gatinois, nous sommes tous un peu beaucoup de la même famille...
J'y ai rencontré une pianiste et son conjoint. Elle était accompagnatrice aux cours de violon de deux de mes filles dans les années 80/90, au mouvement Vivaldi. J'ai appris hier soir qu'elle était Méganticoise et que, par surcroit, elle se trouvait au centre-ville de Lac Mégantic quelques heures seulement avant l'arrivée en trombe du train de la mort. Elle avait quitté la région en fin de soirée et n'a appris le drame que tôt, le lendemain, Mais il s'en est fallu de peu.
D'un coin d'oreille, j'ai entendu quelques hommes, plus âgés que mes 66 ans, prononcer le nom de mon quartier d'enfance à Ottawa, Mechanicsville (ainsi nommé pour honorer les mécaniciens des trains du Canadien Pacifique qui y demeuraient). Je me suis approché et me suis présenté à celui qui avait ranimé ces souvenirs de jeunesse. Il s'agissait d'un vieux prêtre capucin, Armand Soublière, originaire de mon quartier et de ma rue. Il avait été missionnaire au Tchad pendant près de 30 ans et avait survécu à quatre coups d'État, et vivait sa retraite à Gatineau. Hier soir, croix de Tau au cou, il était venu ajouter ses prières aux manifestations de sympathie.
La nuit tombait, après 21 h, et même si la « cérémonie » était terminée, les gens s'attardaient. Comme si on devait faire durer de telles expériences. Comme si on ressentait qu'elles ont, pour chacun, chacune, une grande valeur. Comme si les malheurs étaient toujours plus supportables bien entourés. En famille. En communauté.
Dans Le Devoir de ce matin, Bernard Descôteaux a mis le doigt sur un élément important, en parlant de M. Burkhardt, le grand patron détesté de la compagnie ferroviaire Montreal Maine & Atlantic. « Il ne pouvait pas comprendre l'ampleur du drame, non pas à cause de la barrière de la langue, mais parce que cet entrepreneur n'est que cela, un entrepreneur venu de nulle part, sans lien avec les gens de la collectivité de Mégantic. » Hier soir, nous savions que nous ne venions pas de nulle part, et nous avions des liens avec la collectivité de Mégantic.
Il faudra un jour raconter, sous cet angle, le démantèlement de la compagnie Maclaren, dans le secteur Buckingham-Masson de Gatineau. Vendue vers 1980 à Foresterie Noranda, une entreprise située hors du Québec et n'ayant aucun lien avec la collectivité. Pendant une vingtaine d'année, ces barons étrangers ont vendu l'entreprise pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste rien, laissant derrière eux carrières et vies brisées et des emplois perdus...
Il n'y a pas eu de grand drame comme à Lac-Mégantic, mais il y avait bien des Burkhardt...
Personne ne semblait vraiment avoir « organisé » l'affaire. L'invitation avait tout simplement été lancée dans les médias et plus d'une centaine de personnes y ont répondu. Des jeunes, des vieux, de gens de tous les milieux, ayant en commun cet élan de solidarité pour les familles éprouvées de Lac-Mégantic... et ces chandelles et lampions déposés en cercle un peu avant le coucher du soleil.
L'ambiance était au recueillement. Oh, il y a bien eu quelques allocutions et témoignages, dont celui du maire Marc Bureau qui s'était joint à sa marmaille, mais c'était sans micro et amplification. Il fallait tendre l'oreille pour saisir ces paroles prononcées en douceur. Il n'y avait, pour le reste, que le bourdonnement sourd des conservations... et la musique d'un jeune violoniste venu exprimer à sa façon les émotions ressenties devant tant de vies perdues.
Les participants à cette vigile, pour la plupart, ne se connaissaient pas, mais en de tels moments, les Québécois redeviennent tous un peu cousins, cousines. J'ai en mémoire ma seule visite aux Îles-de-la-Madeleine, en 2002. Nous étions attablés à un restaurant et nous avons amorcé une conversation avec les gens de la table voisine, de parfaits étrangers... En quelques minutes, tous se parlaient d'un bord à l'autre du resto. Un tel venait de Mauricie, l'autre de l'Abitibi, nous de l'Outaouais, certains du Saguenay ou de l'Estrie... en un instant la « famille » s'était reconstituée.
Hier soir, c'était un peu ça. On entendait ça et là les gens parler de leur vie ou de leurs visites à Lac Mégantic (il y avait une dizaine de Méganticois là), de l'horreur de perdre un proche, du souvenir ineffaçable des images de l'explosion, des responsabilités de la compagnie ferroviaire. Des inconnus qui échangeaient comme s'ils s'étaient toujours connus. Méganticois, Gatinois, nous sommes tous un peu beaucoup de la même famille...
J'y ai rencontré une pianiste et son conjoint. Elle était accompagnatrice aux cours de violon de deux de mes filles dans les années 80/90, au mouvement Vivaldi. J'ai appris hier soir qu'elle était Méganticoise et que, par surcroit, elle se trouvait au centre-ville de Lac Mégantic quelques heures seulement avant l'arrivée en trombe du train de la mort. Elle avait quitté la région en fin de soirée et n'a appris le drame que tôt, le lendemain, Mais il s'en est fallu de peu.
D'un coin d'oreille, j'ai entendu quelques hommes, plus âgés que mes 66 ans, prononcer le nom de mon quartier d'enfance à Ottawa, Mechanicsville (ainsi nommé pour honorer les mécaniciens des trains du Canadien Pacifique qui y demeuraient). Je me suis approché et me suis présenté à celui qui avait ranimé ces souvenirs de jeunesse. Il s'agissait d'un vieux prêtre capucin, Armand Soublière, originaire de mon quartier et de ma rue. Il avait été missionnaire au Tchad pendant près de 30 ans et avait survécu à quatre coups d'État, et vivait sa retraite à Gatineau. Hier soir, croix de Tau au cou, il était venu ajouter ses prières aux manifestations de sympathie.
La nuit tombait, après 21 h, et même si la « cérémonie » était terminée, les gens s'attardaient. Comme si on devait faire durer de telles expériences. Comme si on ressentait qu'elles ont, pour chacun, chacune, une grande valeur. Comme si les malheurs étaient toujours plus supportables bien entourés. En famille. En communauté.
Dans Le Devoir de ce matin, Bernard Descôteaux a mis le doigt sur un élément important, en parlant de M. Burkhardt, le grand patron détesté de la compagnie ferroviaire Montreal Maine & Atlantic. « Il ne pouvait pas comprendre l'ampleur du drame, non pas à cause de la barrière de la langue, mais parce que cet entrepreneur n'est que cela, un entrepreneur venu de nulle part, sans lien avec les gens de la collectivité de Mégantic. » Hier soir, nous savions que nous ne venions pas de nulle part, et nous avions des liens avec la collectivité de Mégantic.
Il faudra un jour raconter, sous cet angle, le démantèlement de la compagnie Maclaren, dans le secteur Buckingham-Masson de Gatineau. Vendue vers 1980 à Foresterie Noranda, une entreprise située hors du Québec et n'ayant aucun lien avec la collectivité. Pendant une vingtaine d'année, ces barons étrangers ont vendu l'entreprise pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste rien, laissant derrière eux carrières et vies brisées et des emplois perdus...
Il n'y a pas eu de grand drame comme à Lac-Mégantic, mais il y avait bien des Burkhardt...
mercredi 10 juillet 2013
Les anciennes vidéos - le « Scopitone »
La génération de mes enfants a grandi avec les vidéos de musique à partir du début des années 1980. Des vidéos au sens moderne du terme. Pas seulement des images d'un chanteur ou d'un groupe en en train d'interpréter leur musique sur scène ou en studio - ça, on en voyait depuis l'époque des Beatles - mais de vrais petits films avec scénarios et acteurs, conçus autant pour leur valeur visuelle que musicale.
Je pense souvent à l'une de mes préférées, Cloudbusting, de Kate Bush, qui met en scène dans le rôle principal l'acteur Donald Sutherland. Un grand classique ! Si vous voulez le voir et l'entendre, visitez le site http://bit.ly/1abJp0j.
Image de Donald Sutherland (EMI) dans Cloudbusting
Mais à bien y penser, j'avais vu de véritables vidéos de musique auparavant. Dans la ville de Québec, en 1968 - il y a donc 45 ans cette année. Dans un hôtel en face de la gare, où j'étais arrêté pour prendre un café avec un ami de l'Université d'Ottawa avant de reprendre le train vers l'autre capitale, sur les rives de l'Outaouais. Il y avait dans le restaurant une drôle de machine appelée « Scopitone ».
Ça ressemblait vaguement à un juke-box mais elle était surmontée de ce qui semblait être un écran de télévision - et en couleur ! Pour une description de la technologie du Scopitone, on veut visiter Wikipédia à http://fr.wikipedia.org/wiki/Scopitone ou encore http://www.teppaz-and-co.fr/scopitones.html.
De fait, c'était un juke-box avec vidéo. Ça coûtait plus cher que les juke-box habituels (25 cents je crois...) et les choix étaient limités. J'avais décidé d'essayer et j'ai sélectionné un des premiers méga-succès de Joe Dassin, Les Dalton. J'ai redécouvert cette vidéo sur YouTube et elle vaut vraiment la peine d'être visionnée. Pour l'époque, et même si on voit surtout Joe Dassin habillé en cowboy dans un décor du Far-West, c'était assez révolutionnaire.
Voici l'adresse Internet de la version Scopitone de « Les Dalton » : http://bit.ly/174F8d8.
Et vous voulez chanter avec le regretté Dassin, voici les paroles :
Ecoutez, bonnes gens, la cruelle
Et douloureuse histoire des frères Dalton
Qui furent l´incarnation du mal
Et que ceci serve d´exemple
A tous ceux que le diable écarte du droit chemin.
Tout petits à l´école...
A la place de crayons ils avaient des limes,
En guise de cravates des cordes de lin.
Ne vous étonnez pas, si leur tout premier crime
Fut d´avoir fait mourir leur maman de chagrin.
Tagada, tagada, voilà les Dalton
Tagada, tagada, voilà les Dalton
C´étaient les Dalton
Tagada, tagada, y a plus personne
Les années passèrent...
Ils s´étaient débrouillés pour attraper la rage
Et ficeler le docteur qui faisait les vaccins
Et puis contaminèrent les gens du voisinage
S´amusant à les mordre, puis accusaient les chiens.
Tagada, tagada, voilà les Dalton
Tagada, tagada, voilà les Dalton
C´étaient les Dalton
Tagada, tagada, y a plus personne
Ils devinrent des hommes...
Un conseil, mon ami, avant de les croiser
Embrasse ta femme, serre-moi la main
Vite sur la vie va te faire assurer
Tranche-toi la gorge et jette-toi sous l´train
Tagada, tagada, voilà les Dalton
Tagada, tagada, voilà les Dalton
C´étaient les Dalton
Tagada, tagada, y a plus personne
Mais la Justice veillait...
Comme tous les jours leurs têtes augmentaient d´vingt centimes
des centimes américains
Qu´ils étaient vaniteux et avides d´argent
Ils se livrèrent eux-mêmes pour toucher la prime
Car ils étaient encore plus bêtes que méchants
Tagada, tagada, voilà les Dalton
Tagada, tagada, voilà les Dalton
C´étaient les Dalton
Tagada, tagada, y a plus personne
Voilà qui égaye un mercredi de juillet plutôt gris. Tagada, tagada. J'ai toujours aimé ça... Et ça me rappelle ma jeune vingtaine...
Je pense souvent à l'une de mes préférées, Cloudbusting, de Kate Bush, qui met en scène dans le rôle principal l'acteur Donald Sutherland. Un grand classique ! Si vous voulez le voir et l'entendre, visitez le site http://bit.ly/1abJp0j.
Image de Donald Sutherland (EMI) dans Cloudbusting
Mais à bien y penser, j'avais vu de véritables vidéos de musique auparavant. Dans la ville de Québec, en 1968 - il y a donc 45 ans cette année. Dans un hôtel en face de la gare, où j'étais arrêté pour prendre un café avec un ami de l'Université d'Ottawa avant de reprendre le train vers l'autre capitale, sur les rives de l'Outaouais. Il y avait dans le restaurant une drôle de machine appelée « Scopitone ».
Ça ressemblait vaguement à un juke-box mais elle était surmontée de ce qui semblait être un écran de télévision - et en couleur ! Pour une description de la technologie du Scopitone, on veut visiter Wikipédia à http://fr.wikipedia.org/wiki/Scopitone ou encore http://www.teppaz-and-co.fr/scopitones.html.
De fait, c'était un juke-box avec vidéo. Ça coûtait plus cher que les juke-box habituels (25 cents je crois...) et les choix étaient limités. J'avais décidé d'essayer et j'ai sélectionné un des premiers méga-succès de Joe Dassin, Les Dalton. J'ai redécouvert cette vidéo sur YouTube et elle vaut vraiment la peine d'être visionnée. Pour l'époque, et même si on voit surtout Joe Dassin habillé en cowboy dans un décor du Far-West, c'était assez révolutionnaire.
Voici l'adresse Internet de la version Scopitone de « Les Dalton » : http://bit.ly/174F8d8.
Et vous voulez chanter avec le regretté Dassin, voici les paroles :
Ecoutez, bonnes gens, la cruelle
Et douloureuse histoire des frères Dalton
Qui furent l´incarnation du mal
Et que ceci serve d´exemple
A tous ceux que le diable écarte du droit chemin.
Tout petits à l´école...
A la place de crayons ils avaient des limes,
En guise de cravates des cordes de lin.
Ne vous étonnez pas, si leur tout premier crime
Fut d´avoir fait mourir leur maman de chagrin.
Tagada, tagada, voilà les Dalton
Tagada, tagada, voilà les Dalton
C´étaient les Dalton
Tagada, tagada, y a plus personne
Les années passèrent...
Ils s´étaient débrouillés pour attraper la rage
Et ficeler le docteur qui faisait les vaccins
Et puis contaminèrent les gens du voisinage
S´amusant à les mordre, puis accusaient les chiens.
Tagada, tagada, voilà les Dalton
Tagada, tagada, voilà les Dalton
C´étaient les Dalton
Tagada, tagada, y a plus personne
Ils devinrent des hommes...
Un conseil, mon ami, avant de les croiser
Embrasse ta femme, serre-moi la main
Vite sur la vie va te faire assurer
Tranche-toi la gorge et jette-toi sous l´train
Tagada, tagada, voilà les Dalton
Tagada, tagada, voilà les Dalton
C´étaient les Dalton
Tagada, tagada, y a plus personne
Mais la Justice veillait...
Comme tous les jours leurs têtes augmentaient d´vingt centimes
des centimes américains
Qu´ils étaient vaniteux et avides d´argent
Ils se livrèrent eux-mêmes pour toucher la prime
Car ils étaient encore plus bêtes que méchants
Tagada, tagada, voilà les Dalton
Tagada, tagada, voilà les Dalton
C´étaient les Dalton
Tagada, tagada, y a plus personne
Voilà qui égaye un mercredi de juillet plutôt gris. Tagada, tagada. J'ai toujours aimé ça... Et ça me rappelle ma jeune vingtaine...
mardi 9 juillet 2013
Les 50 ans de la Commission B-B
Caricature du Devoir, signée Berthio, de juillet 1963
Le gouvernement Harper semble choisir les anniversaires qu'il faut « vraiment » célébrer en fonction de l'usage qu'il peut « vraiment » en faire... Le bicentenaire de la guerre de 1812 lui permettait, en la tripotant un peu beaucoup, d'attiser des braises monarchiques et militaires qui servaient fort bien les orientations du Parti conservateur. On ne peut qu'imaginer le « spin » que le gouvernement actuel voudra mettre sur la préparation des 150 bougies de la Confédération en 2017... une propagande mur à mur sur notre beau et grand bilingue et multiculturel pays...
Pour célébrer la lutte pour la démocratie et le gouvernement responsable, on aurait mieux fait d'investir un dans la commémoration du 175e anniversaire des rébellions de 1837-1838, au Bas-Canada mais également dans le Haut-Canada. Mais c'était une rébellion anti-royaliste, voire républicaine. Ô horreur... Donc pas de budget pour ça... On aurait pu aussi prévoir un grand déploiement de mesures pour souligner le cinquantenaire de la la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (la Commission B-B), créée le 19 juillet 1963.
Cette Commission fut la première reconnaissance officielle à Ottawa, par un gouvernement minoritaire libéral ayant à sa tête Lester B. Pearson, de l'existence au Québec d'un problème de fond qui remettait en question les rapports de « la belle province » avec l'ensemble du pays. Et c'était aussi, enfin, une reconnaissance que le fond de cette crise était d'ordre linguistique et culturel. Les conservateurs sous Diefenbaker (ou Harper) n'auraient pas institué une telle commission. Les libéraux sous Pierre Elliott Trudeau non plus. La fenêtre de lucidité s'est entrouverte pour quelques années seulement...
Le mandat de la Commission B-B, présidée par André Laurendeau, éditeur du quotidien Le Devoir, et Davidson Dunton, président de l'Université Carleton, à Ottawa, affirmait pour la toute première fois l'égalité de l'anglais et du français et des peuples qui les parlaient sur le territoire canadien. Une égalité individuelle et collective. Denis Monière, un de mes anciens collègues à la faculté des Sciences sociales de l'Université d'Ottawa à cette époque, rappelle bien les circonstances dans son livre* sur André Laurendeau :
« Laurendeau hésita avant d'accepter cette nomination. Il avait certes été l'instigateur de cette commission qui lui offrait de concrétiser sa conception des relations entre le Canada français et le Canada anglais, mais il craignait que cette fonction ne l'éloigne du Québec alors en pleine ébullition.
« On était au temps fort de la Révolution tranquille, en pleine bataille du Bill 60. Le Québec était secoué par les bombes du FLQ, alors que se déroulaient les enquêtes préliminaires des felquistes de la première vague. Marcel Chaput avait aussi entrepris une grève de la faim pour financer le Parti républicain du Québec.
« Alors qu'il était l'une des voix les plus écoutées au Québec où il pouvait jouer un rôle important, Laurendeau risquait, à titre de coprésident, de se retrouver sur un terrain politique où son influence serait aléatoire. (...)
« Dans un éditorial publié le 23 juillet, il expliqua aux lecteurs du Devoir les raisons de sa décision (d'accepter la coprésidence de la Commission B-B). En dépit du caractère périlleux de l'entreprise, qui risquait de soulever des passions, de cautionner une politique centralisatrice qu'il avait toujours combattue ou encore de se heurter à un mur d'incompréhension, il se devait d'accepter cette mission car, écrit-il, "c'est le destin d'un peuple qui est en cause".
« Pour la première fois, le gouvernement central, en créant cette commission, acceptait le principe de l'égalité et l'appliquait dans les faits. "Voilà trente ans que je me bats pour l'égalité. Je réclame la tenue d'une enquête depuis janvier 1962. J'ai défendu l'idée dans vingt articles. J'y crois. J'y plonge.
« Cette commission lui donnait l'occasion de poursuivre un dialogue ouvert avec le Canada anglais. Laurendeau croyait que la crise canadienne résultait en grande partie de l'ignorance et de l'incompréhension entre les deux peuples fondateurs. Il espérait par le travail de la commission briser les deux solitudes, abattre les palissades qui empêchaient les deux groupes de se comprendre et sensibiliser le Canada anglais aux besoins et aux aspirations des Québécois.
« Laurendeau entreprit cette mission pédagogique avec un optimisme modéré. Pour lui, l'enjeu de cette enquête était dramatique : "Ou nous sortirons de l'enquête un peu plus séparatistes qu'auparavant, ou nous en ressortirons convaincus que la coexistence avec le groupe de langue anglaise est possible et mutuellement fructueuse." »
André Laurendeau n'aura pas vu la fin des travaux. Il est mort en 1968, avant la publication du rapport final. De toute façon, il n'aurait vu que l'échec de son oeuvre. Trudeau avait pris le pouvoir, et a tout saboté. La Commission B-B aura été la première et dernière tentative, par Ottawa, de réconcilier deux nations égales dans une structure fédérale. Juillet 1963. Un mois important. Un anniversaire important. Bien plus que celui de la guerre de 1812....
* Denis Monière, André Laurendeau, Éditions Québec/Amérique, Montréal, 1983.
lundi 8 juillet 2013
Les trains de mon enfance
J'ai passé mon enfance tout près d'une voie ferrée, dans l'ouest d'Ottawa. Les rails traversaient le centre de notre quartier essentiellement francophone, le sectionnant : le secteur St-François d'Assise au sud (moins pauvre) et Mechanicsville (prononcer Mécanique-ss-ville) adossé à la rivière des Outaouais. Le sifflement et le chougg-chougg-chougg des locomotives à vapeur en accélération, suivi qui claque-e-claque des wagons sur les rails d'acier faisaient partie de notre quotidien.
Je demeurais au coeur de Mechanicsville. Nos mères pestaient parfois contre le transport ferroviaire quand le vent du sud transportait la « fumée » des locomotives jusque sur leurs cordes à linge, le lundi (journée de lessive je crois). Mais pour plusieurs d'entre nous, les trains étaient une interminable source de joie et de plaisir. Nous aimions rôder autour d'une immense structure circulaire vitrée et sale, contenant une plaque tournante remplie de belles locomotives à vapeur sur des rails disposés comme des rayons vers l'extérieur à partir du centre.
À côté il y avait la vieille gare du Canadien Pacifique, aujourd'hui démolie comme le carrousel des locomotives, remplacés par un centre sportif et un pont... Même la voie ferrée est-ouest a disparu, cédant sa place à une voie rapide pour autobus... Mais dans notre enfance, je ne compte pas le nombre de fois où nous avons marché en équilibre sur les rails, y collant à l'occasion une oreille pour entendre la vibration lointaine d'un train en approche, certains y déposant un sou pour conserver dans leur collection une pièce de monnaie aplatie par une locomotive...
Nous aimions aussi rester blottis près du fossé avoisinant les rails pour voir de très près les convois, compter le nombre de wagons, lire les inscriptions, imaginer leur contenu... jusqu'au wagon de queue (la cabousse...). Nous savions que c'était dangereux, et que nos parents n'auraient guère apprécié de savoir que la voie ferrée était un de nos terrains de jeux... Sans doute le savaient-ils au fond, eux qui avaient grandi dans le même quartier... Mais pour nous, enfants parfois trop confiants, les trains n'étaient que des amis... Je ne serais pas surpris que l'engouement pour les trains électriques, comme jouets pour jeunes et adultes, ait atteint son apogée à cette époque (les années 1950).
J'ai demeuré là assez longtemps pour voir la disparition des trains à vapeur et l'arrivée des diésels argentés scintillants. Puis nous avons quitté le quartier et les chemins de fer sont devenus d'heureux souvenirs d'enfance. Jamais d'accident majeur, que je me souvienne. Jamais de tragédie qui m'a marquée. Une cohabitation paisible et agréable, sauf pour les vents du sud les journées de lessive...
Puis alors que j'étais déjà journaliste dans les années 1970, un collègue a perdu la vie, mourant au bout de son sang après qu'un train eut amputé une de ses jambes en pleine nuit dans l'ancienne ville de Hull. Le train ne s'était jamais arrêté et personne n'avait été témoin de l'accident. Il avait sur lui une enregistreuse, et avait laissé un enregistrement de son agonie et de ses dernières paroles. Quelle horreur. Une tache de sang sur mes souvenirs de rails propres et luisants d'autrefois.
Puis, cette fin de semaine, Lac Mégantic. Là aussi, la voie ferrée côtoyait habitations et commerces. Depuis toujours. Les enfants, les adolescents, les adultes, tous la traversaient quotidiennement. Tous ont dû marcher sur les rails, se blottir dans un fossé pour compter les wagons, s'endormir ou s'éveiller en entendant le claque-e-claque des wagons... sans jamais s'y sentir en danger. On a comme cette confiance innée que les responsables ferroviaires ne mettraient pas nos vies à risque, et qu'à moins d'imprudence de notre part, les trains logent du côté heureux de notre cerveau...
Et puis en un instant, tout saute. Un mur de feu souffle un quartier et toutes les vies humaines innocentes qui n'avaient commis aucune imprudence et qui, comme moi dans mon enfance, n'avaient aucun sens qui danger mortel qui les guettait, s'éteignent. Parce qu'ailleurs, des imprudences, des fautes ou des accidents de parcours avaient signé leur arrêt de mort...
Une des morales de cette histoire, pour moi du moins? Le passé fait partie du présent, et chaque nouvelle expérience en colore nos perceptions. Ce matin, mes souvenirs d'enfance sont ternis...
Je demeurais au coeur de Mechanicsville. Nos mères pestaient parfois contre le transport ferroviaire quand le vent du sud transportait la « fumée » des locomotives jusque sur leurs cordes à linge, le lundi (journée de lessive je crois). Mais pour plusieurs d'entre nous, les trains étaient une interminable source de joie et de plaisir. Nous aimions rôder autour d'une immense structure circulaire vitrée et sale, contenant une plaque tournante remplie de belles locomotives à vapeur sur des rails disposés comme des rayons vers l'extérieur à partir du centre.
À côté il y avait la vieille gare du Canadien Pacifique, aujourd'hui démolie comme le carrousel des locomotives, remplacés par un centre sportif et un pont... Même la voie ferrée est-ouest a disparu, cédant sa place à une voie rapide pour autobus... Mais dans notre enfance, je ne compte pas le nombre de fois où nous avons marché en équilibre sur les rails, y collant à l'occasion une oreille pour entendre la vibration lointaine d'un train en approche, certains y déposant un sou pour conserver dans leur collection une pièce de monnaie aplatie par une locomotive...
Nous aimions aussi rester blottis près du fossé avoisinant les rails pour voir de très près les convois, compter le nombre de wagons, lire les inscriptions, imaginer leur contenu... jusqu'au wagon de queue (la cabousse...). Nous savions que c'était dangereux, et que nos parents n'auraient guère apprécié de savoir que la voie ferrée était un de nos terrains de jeux... Sans doute le savaient-ils au fond, eux qui avaient grandi dans le même quartier... Mais pour nous, enfants parfois trop confiants, les trains n'étaient que des amis... Je ne serais pas surpris que l'engouement pour les trains électriques, comme jouets pour jeunes et adultes, ait atteint son apogée à cette époque (les années 1950).
J'ai demeuré là assez longtemps pour voir la disparition des trains à vapeur et l'arrivée des diésels argentés scintillants. Puis nous avons quitté le quartier et les chemins de fer sont devenus d'heureux souvenirs d'enfance. Jamais d'accident majeur, que je me souvienne. Jamais de tragédie qui m'a marquée. Une cohabitation paisible et agréable, sauf pour les vents du sud les journées de lessive...
Puis alors que j'étais déjà journaliste dans les années 1970, un collègue a perdu la vie, mourant au bout de son sang après qu'un train eut amputé une de ses jambes en pleine nuit dans l'ancienne ville de Hull. Le train ne s'était jamais arrêté et personne n'avait été témoin de l'accident. Il avait sur lui une enregistreuse, et avait laissé un enregistrement de son agonie et de ses dernières paroles. Quelle horreur. Une tache de sang sur mes souvenirs de rails propres et luisants d'autrefois.
Puis, cette fin de semaine, Lac Mégantic. Là aussi, la voie ferrée côtoyait habitations et commerces. Depuis toujours. Les enfants, les adolescents, les adultes, tous la traversaient quotidiennement. Tous ont dû marcher sur les rails, se blottir dans un fossé pour compter les wagons, s'endormir ou s'éveiller en entendant le claque-e-claque des wagons... sans jamais s'y sentir en danger. On a comme cette confiance innée que les responsables ferroviaires ne mettraient pas nos vies à risque, et qu'à moins d'imprudence de notre part, les trains logent du côté heureux de notre cerveau...
Et puis en un instant, tout saute. Un mur de feu souffle un quartier et toutes les vies humaines innocentes qui n'avaient commis aucune imprudence et qui, comme moi dans mon enfance, n'avaient aucun sens qui danger mortel qui les guettait, s'éteignent. Parce qu'ailleurs, des imprudences, des fautes ou des accidents de parcours avaient signé leur arrêt de mort...
Une des morales de cette histoire, pour moi du moins? Le passé fait partie du présent, et chaque nouvelle expérience en colore nos perceptions. Ce matin, mes souvenirs d'enfance sont ternis...
vendredi 5 juillet 2013
Ça va comme c'est mené...
S'il y a une chose que les Franco-Ontariens devraient avoir bien appris, c'est ce qui finit par leur arriver quand ils sont entièrement à la merci d'une majorité ou d'une direction anglophone... C'est pour cette raison qu'ils ont lutté et obtenu de peine et de misère le droit d'administrer leurs propres écoles et leurs propres commissions scolaires de langue française. Et que dire de l'hôpital Montfort. Laissé aux « bons soins » de Queen's Park, il aurait cessé d'exister. Grâce à une décision heureuse des tribunaux, il a échappé aux griffes de vous-savez-qui et appartient maintenant à la communauté franco-ontarienne.
Les francophones de la grande région d'Ottawa n'ont pas eu la main aussi heureuse en éducation supérieure et en affaires religieuses. En effet, deux institutions où ils ont été longtemps en majorité (ils ne le sont plus) et où ils se sont considérés chez eux, l'Université d'Ottawa et l'Archidiocèse catholique d'Ottawa, leur échappe de plus en plus. Dans un éditorial intitulé « Espaces francophones » et publié dans Le Droit en octobre 2005, j'avais évoqué cette situation et invité l'Université d'Ottawa à songer à des solutions, y compris la création possible - tout au moins - d'un campus de langue française.
L'Université d'Ottawa
Quelques jours plus tard, le recteur Gilles Patry et quelques-uns de ses adjoints venaient nous rendre visite, au journal, pour discuter de la situation. Ces derniers avaient vaillamment plaidé leur cause, notant avec justesse l'augmentation de l'offre et de la qualité des programmes en français de l'Université d'Ottawa. Ils avaient aussi insisté sur le fait que l'administration de l'Université restait largement francophone et qu'il y avait là une protection de taille pour la francophonie ontarienne. Oui, ai-je alors dit au recteur, mais qu'arrivera-t-il le jour où un anglophone vous remplacera, et cela finira bien par arriver un jour...
Le recteur Patry devait quitter son poste quelques années plus tard et a été remplacé en juillet 2008 par Allan Rock, un anglophone assez bilingue, ancien ministre libéral fédéral sous Jean Chrétien. On dira ce que l'on voudra, mais ils ont été rares, dans l'histoire canadienne, les anglophones en position de pouvoir qui ont pris le bâton de pèlerin pour promouvoir les droits des francophones. Dans tout le cafouillage récent entourant la protection (ou pas) de l'Université d'Ottawa en vertu de la Loi ontarienne sur les services en français, la direction de l'institution a été plus qu'hésitante...
Dernièrement, le recteur Rock parle d'un possible campus de langue française dans la région de... Windsor. Surtout pas où se situe la masse des 10 000 et plus étudiants francophones de l'Université... c'est-à-dire à Ottawa même. Et hier, dans cette ambiance de flottement, on apprend qu'il y aura au coeur du campus un « Monument de la francophonie », sauf que contrairement aux autres monuments du même genre ailleurs dans la région, il n'y aura pas de drapeau franco-ontarien géant. Selon un article du Droit, « l'Université s'est opposée à cette idée afin de ne pas froisser la communauté anglophone » !
Froisser la minorité franco-ontarienne n'a jamais dérangé personne dans cette province, mais faut-il que Dieu nous protège de tout ce qui pourrait alimenter la paranoïa anglo dans la capitale fédérale? Pas de drapeau au coeur du campus pour ne pas « froisser » les Anglais? Manquer de couilles à ce point relève du scandale et et j'espère qu'au moins quelques dirigeants franco-ontariens se chargeront de frotter publiquement les oreilles du recteur à ce sujet. Si on mouille ses caleçons à cause d'un mat et d'un drapeau, que fera-t-on devant le beaucoup plus sérieux dossier d'une université francophone?
L'Archidiocèse d'Ottawa
Du côté de la religion, l'Archidiocèse d'Ottawa est dirigé depuis 2007 par un anglophone, Mgr Terrence Prendergast. Sans doute un sympathique bonhomme, mais dans l'histoire de l'Ontario, d'autres évêques de langue anglaise - y compris Mgr Fallon et Mgr Smith - ont beurré leurs « toasts » avec notre foi et notre langue depuis l'époque du Règlement 17. On nous pardonnera de conserver une méfiance qui résulte largement de l'expérience vécue.
Quoiqu'il en soit, et tout en admettant que les églises se vident et qu'il faut bien en fermer ici et là, les paroisses canadiennes-françaises d'Ottawa ont été au coeur des luttes linguistiques du dernier siècle et les temples sont des monuments culturels autant que religieux. Il est sans doute difficile de faire comprendre à un anglophone - fut-il archevêque - l'émotion que peuvent ressentir des Franco-Ontariens devant l'église Ste-Anne ou l'église St-Charles. Les paroissiens francophones de la Basse-Ville ont perdu leur église et ont été annexés à une paroisse « bilingue »...
Dans le secteur Vanier, on discute maintenant de l'église St-Charles, « véritable phare de la francophonie » qui a vu la naissance de l'ancien Ordre de Jacques-Cartier (la Patente) en 1926. L'archidiocèse a fermé l'église en 2010, et, selon un article récent du Droit, on est « sans nouvelles de l'archidiocèse depuis plus d'un an ». Tous les soupçons sont permis... et on jugera aux résultats.
L'histoire a démontré que la charité chrétienne, même au sein de l'Église catholique ontarienne, ne s'étendait pas toujours aux francophones. On a des commissions scolaires linguistiques. Pourquoi pas des diocèses aussi? Au moins les francophones régleraient leurs propres affaires.
Les francophones de la grande région d'Ottawa n'ont pas eu la main aussi heureuse en éducation supérieure et en affaires religieuses. En effet, deux institutions où ils ont été longtemps en majorité (ils ne le sont plus) et où ils se sont considérés chez eux, l'Université d'Ottawa et l'Archidiocèse catholique d'Ottawa, leur échappe de plus en plus. Dans un éditorial intitulé « Espaces francophones » et publié dans Le Droit en octobre 2005, j'avais évoqué cette situation et invité l'Université d'Ottawa à songer à des solutions, y compris la création possible - tout au moins - d'un campus de langue française.
L'Université d'Ottawa
Quelques jours plus tard, le recteur Gilles Patry et quelques-uns de ses adjoints venaient nous rendre visite, au journal, pour discuter de la situation. Ces derniers avaient vaillamment plaidé leur cause, notant avec justesse l'augmentation de l'offre et de la qualité des programmes en français de l'Université d'Ottawa. Ils avaient aussi insisté sur le fait que l'administration de l'Université restait largement francophone et qu'il y avait là une protection de taille pour la francophonie ontarienne. Oui, ai-je alors dit au recteur, mais qu'arrivera-t-il le jour où un anglophone vous remplacera, et cela finira bien par arriver un jour...
Le recteur Patry devait quitter son poste quelques années plus tard et a été remplacé en juillet 2008 par Allan Rock, un anglophone assez bilingue, ancien ministre libéral fédéral sous Jean Chrétien. On dira ce que l'on voudra, mais ils ont été rares, dans l'histoire canadienne, les anglophones en position de pouvoir qui ont pris le bâton de pèlerin pour promouvoir les droits des francophones. Dans tout le cafouillage récent entourant la protection (ou pas) de l'Université d'Ottawa en vertu de la Loi ontarienne sur les services en français, la direction de l'institution a été plus qu'hésitante...
Dernièrement, le recteur Rock parle d'un possible campus de langue française dans la région de... Windsor. Surtout pas où se situe la masse des 10 000 et plus étudiants francophones de l'Université... c'est-à-dire à Ottawa même. Et hier, dans cette ambiance de flottement, on apprend qu'il y aura au coeur du campus un « Monument de la francophonie », sauf que contrairement aux autres monuments du même genre ailleurs dans la région, il n'y aura pas de drapeau franco-ontarien géant. Selon un article du Droit, « l'Université s'est opposée à cette idée afin de ne pas froisser la communauté anglophone » !
Froisser la minorité franco-ontarienne n'a jamais dérangé personne dans cette province, mais faut-il que Dieu nous protège de tout ce qui pourrait alimenter la paranoïa anglo dans la capitale fédérale? Pas de drapeau au coeur du campus pour ne pas « froisser » les Anglais? Manquer de couilles à ce point relève du scandale et et j'espère qu'au moins quelques dirigeants franco-ontariens se chargeront de frotter publiquement les oreilles du recteur à ce sujet. Si on mouille ses caleçons à cause d'un mat et d'un drapeau, que fera-t-on devant le beaucoup plus sérieux dossier d'une université francophone?
L'Archidiocèse d'Ottawa
Du côté de la religion, l'Archidiocèse d'Ottawa est dirigé depuis 2007 par un anglophone, Mgr Terrence Prendergast. Sans doute un sympathique bonhomme, mais dans l'histoire de l'Ontario, d'autres évêques de langue anglaise - y compris Mgr Fallon et Mgr Smith - ont beurré leurs « toasts » avec notre foi et notre langue depuis l'époque du Règlement 17. On nous pardonnera de conserver une méfiance qui résulte largement de l'expérience vécue.
Quoiqu'il en soit, et tout en admettant que les églises se vident et qu'il faut bien en fermer ici et là, les paroisses canadiennes-françaises d'Ottawa ont été au coeur des luttes linguistiques du dernier siècle et les temples sont des monuments culturels autant que religieux. Il est sans doute difficile de faire comprendre à un anglophone - fut-il archevêque - l'émotion que peuvent ressentir des Franco-Ontariens devant l'église Ste-Anne ou l'église St-Charles. Les paroissiens francophones de la Basse-Ville ont perdu leur église et ont été annexés à une paroisse « bilingue »...
Dans le secteur Vanier, on discute maintenant de l'église St-Charles, « véritable phare de la francophonie » qui a vu la naissance de l'ancien Ordre de Jacques-Cartier (la Patente) en 1926. L'archidiocèse a fermé l'église en 2010, et, selon un article récent du Droit, on est « sans nouvelles de l'archidiocèse depuis plus d'un an ». Tous les soupçons sont permis... et on jugera aux résultats.
L'histoire a démontré que la charité chrétienne, même au sein de l'Église catholique ontarienne, ne s'étendait pas toujours aux francophones. On a des commissions scolaires linguistiques. Pourquoi pas des diocèses aussi? Au moins les francophones régleraient leurs propres affaires.
jeudi 4 juillet 2013
Mystère résolu. La photo n'est pas truquée...
Si la photo est réellement croquée sur le pont (ce qui semble probable étant donné que les techniques de trucage de photos étaient moins perfectionnées à l'époque), il a fallu déployer beaucoup d'efforts. Se rendre de Montréal à Hull/Ottawa en voiture ou en trouver une sur place, prévoir au moins deux participants, le conducteur et le simili agent de douanes, apporter ou louer ou confectionner une barrière et une affiche Douanes Québec/Canada customs ainsi que l'uniforme de l'agent de douanes et le faux passeport québécois, trouver un moment (rare) où l'absence de circulation permet de tout installer et de prendre la photo ou, pire, arrêter les voitures en direction du Québec pour quelques minutes... ce qui n'est pas évident.
Et, pour ceux qui n'ont pas mon âge (66 ans), il faut souligner qu'à l'époque (un peu avant la crise d'octobre), le climat politique était très tendu dans la capitale canadienne et que dans la région d'Ottawa, les autorités municipales, provinciales et fédérales n'auraient probablement pas collaboré à ce genre de montage pour un journal étudiant de Montréal à tendance indépendantiste...
La réponse
Eh bien, ce matin, j'ai eu la réponse à mon interrogation de plus de 40 ans... J'ai réussi à joindre par téléphone le concepteur de la page, Jean Gladu, qui était en 1969 un des directeurs de l'équipe du Quartier latin. Il s'était rendu à Gatineau dans sa Volvo verte (illustrée dans la photo) accompagné de trois ou quatre étudiants.
« Nous avons fabriqué la barrière nous-mêmes, avons inventé une sorte de costume pour le douanier et avons attendu un moment où la circulation s'est arrêtée pendant trois ou quatre minutes » pour installer le décor et prendre les photos, a-t-il expliqué. C'est en effet un événement qu'il serait difficile d'oublier pour ceux qui y ont participé, même si plus de quatre décennies d'eau ont coulé sous les ponts de l'Outaouais depuis la fin des années 1960. « Y'avait rien à notre épreuve », ajoute-t-il.
Mystère résolu ! Ça me chicotait depuis longtemps.
D'une page à l'autre
Au-delà de la page couverture, qui annonce quelques reportages sur les scénarios d'une possible souveraineté du Québec, le magazine étudiant de Montréal est fascinant à feuilleter. En page 4, le cinéma Vendome de la métropole présente le film « Z » de Costa Gavras, grand gagnant du Festival de Cannes 1969. À la page suivante, une méga publicité de la bière Laurentide avec son slogan « toujours d'la partie ! » et l'image, en caricature, des Jérolas, Jérôme Lemay et Jean Lapointe. Avec une photo des anciennes petites bouteilles de bière... À noter que la fabricants de bière semblent apprécier le marché étudiant, puisque les marques O'Keefe et Labatt 50 sont aussi présentes. On y voit toujours des annonces de cigarettes, l'Export A entre autres... qui se dit « la meilleure cigarette au Canada ».
À noter aussi que ce magazine, même s'il était produit par les étudiants de l'Université de Montréal, était vendu 50 cents en kiosque partout au Québec, et même à Ottawa, et son contenu reflétait la réalité étudiante francophone de toutes les régions, en plus d'aborder les questions sociales et politiques du pays et de la planète. Il y a d'ailleurs un article intéressant sur l'Université d'Ottawa, mon alma mater, intitulé « C'est l'affrontement », faisant état d'articles injurieux à l'endroit des francophones dans un magazine étudiant appelé Foetus. Une assemblée générale étudiante caractérisée par la violence verbale entre francophones et anglophones avait suivi...
Comment tout cela a-t-il fini? L'histoire ne le dit pas...
mercredi 3 juillet 2013
Adieu Joseph Costisella, avec huit ans de retard...
Ces jours-ci, pendant que je transforme mon ancien bureau (à la maison) en salle d'études, de lecture, de rédaction et de musique, je refais aussi les tablettes de mes bibliothèques, jetant un coup d'oeil sur mes livres, un à un, les dépoussiérant au besoin. Et là, je suis tombé sur un livre assez particulier, intitulé Le scandale des écoles séparées en Ontario, publié aux Éditions de l'homme, à Montréal, en 1962 et vendu au prix modique de 1,00 $. Comme je n'avais que 16 ans à l'époque, je l'ai sans doute acheté vers la fin des années 1960 à ma librairie préférée, « Le coin du livre », dans la Basse-Ville d'Ottawa.
À l'intérieur de ce petit ouvrage d'à peine 120 pages, j'ai retrouvé l'avis de décès de l'auteur, Joseph Costisella, paru dans le quotidien Le Droit. Un tout petit avis de décès, sur une seule petite colonne, avec une photo de piètre qualité, qui résumait ainsi sa vie : « La famille Costisella a le regret et la tristesse de vous faire part du décès subit de M. Joseph Costisella, à l'âge de 70 ans, le 12 juillet 2005. Docteur d'État ès Lettres, écrivain, journaliste et professeur, il était le fils de la Comtesse Erdödy et de M. Antoine Costisella. »
Je ne me souviens pas d'avoir lu d'articles dans les journaux à l'occasion de sa mort ou d'avoir entendu de commentaires sur la vie et l'oeuvre de ce singulier personnage. Cela m'avait d'ailleurs fait penser aux paroles de Raymond Lévesque dans sa chanson Bozo-les-culottes : « Quand on est d'la race des pionniers, on est fait pour être oublié ». Joseph Costisella est mort dans un relatif oubli, presque dans l'anonymat, et à part ses enfants et petits-enfants qui en perpétuent sans doute le souvenir en famille, ce qui reste de lui orne les rayons de bibliothèques privées, ça et là, comme chez moi.
Mais Joseph Costisella a été à sa façon un défricheur. Il était arrivé de France, sa terre natale, à la fin des années 1950 et avait jeté son regard « d'étranger » sur nos luttes nationales, au Québec mais aussi en Ontario, où les Canadiens français étaient victimes depuis l'époque du Règlement 17 d'un racisme palpable. Comme bien des minorités opprimées, les Franco-Ontariens étaient usés par une lutte qui n'en finissait plus, et le langage de combat de l'époque de la Première Guerre mondiale (l'époque du Règlement 17) avait cédé la place au ton doucereux des rapports et mémoires répétant, d'année en année, sur un ton de plus en plus résigné, les mêmes supplications à des gouvernements sans merci.
Joseph Costisella arriva à Ottawa avec un bagage différent. Voici comment il se présente dans un Avertissement au début du fascicule Le scandale des écoles séparées en Ontario :
« Pourquoi ce livre sur le racisme à Ottawa, et dans tout le Canada, racisme qui frappe aveuglément les Canadiens français?
« J'habite Ottawa depuis deux ans (nous sommes en 1962). On y remarque toutes sortes de petites vexations, que subissent les Franco-Ontariens; depuis le léger mépris de l'Anglais distingué, jusqu'aux injures ordurières. En fait, n'y prêtent attention que ceux que le racisme vise. Et puis, un jour, au cours d'un interview avec un écrivain de la capitale, j'ai découvert qu'il existait tout un plan concerté, appuyé par des lois extrêmement habiles, pour détruire, puis assimiler les Franco-Ontariens. Patiemment, j'ai fait enquête, et cette enquête porte sur des faits précis et vécus. En voici le résultat.
« Né en France, de parents austro-hongrois, j'ai moi-même été témoin du racisme, surtout dans mon enfance, puis au collège. J'a vu le racisme des Allemands contre les Juifs: mon premier ami d'enfance, Richard Loewenstein, est mort au camp de concentration de Dachau, en 1944. Puis, celui des Français contre les peuples de couleur: tout le problème colonial de 1945 à 1959. Le racisme contre les Arabes d'Algérie m'a touché de très près. (...)
« Le racisme ne mène à rien, sauf au néant et à la destruction d'une société. Le racisme à Ottawa met en danger l'existence de tout le Canada. Dans le sens normal de l'histoire, il est inévitable que, lorsque une race cherche à en écraser une autre, des troubles graves se produisent. Car tous, nous aspirons à la justice. »
J'étais franco-ontarien à l'époque (j'habite à Gatineau depuis le milieu des années 1970), et on n'avait jamais entendu quelqu'un parler de nous en de tels termes, d'une telle perspective. Ce que certains d'entre nous ressentions confusément nous apparaissait tout à coup dans un livre, sous la plume d'un Européen... L'éminent historien et prêtre Gustave Lamarche l'avait noté, dans sa présentation d'un autre livre de M. Costisella, L'esprit révolutionnaire dans la littérature canadienne-française : « Je trouvais admirable, écrit M. Lamarche, que cet étranger, ayant à peine mis les pieds au pays, se soit aperçu de notre malheur invétéré et nous l'ait révélé mieux que d'autres. »
Personne n'avait qualifié la Basse-Ville, principal quartier francophone de la capitale à cette époque, de « Harlem d'Ottawa ». Personne n'était allé rencontrer des familles, des enseignants, des commerçants franco-ontariens pour raconter dans un livre leur vécu, les taxes payées en trop, les salaires moins élevés, la pauvreté, la « grande misère » des écoles bilingues-françaises, l'absence d'écoles secondaires de langue française, et que dire de l'enseignement supérieur.
Personne n'était allé confronter des politiciens anglophones , style Michael Moore, pour les interroger sur le racisme dont étaient victimes les francophones de la capitale fédérale. Telle cette entrevue avec le Dr Storr, un des administrateurs de l'Ottawa Public School Board, dans ses bureaux devant lesquels claquait au vent l'Union Jack... Allez-vous condamner les Franco-Ontariens à la misère ou l'anglicisation parce qu'ils veulent conserver leur culture, lui demande Joseph Costisella. « S'ils ne sont pas satisfaits, qu'ils retournent chez eux, dans le Québec », répond l'autre...
La couverture de l'ouvrage visait elle-même l'effet choc, avec l'image d'une immense pieuvre, le mot « racisme » écrit sur sa tête et une école franco-ontarienne dans ses tentacules. Du début à la fin, l'auteur attaquait sur la place publique une réalité avec laquelle nous avions accepté de composer sans rouspéter trop fort. Le livre a valu à Joseph Costisella la mention « personnalité de l'année 1962 » du quotidien Le Droit. L'auteur devait publier deux autres ouvrages percutants, Peuple de la nuit, Histoire des Québécois, en 1965, et sa thèse de doctorat, L'esprit révolutionnaire dans la littérature canadienne française, en 1968.
J'aime croire que tant que je conserve mes livres, mes vieux journaux et ces quelques avis nécrologiques, la mémoire de leurs auteurs reste vivante. Quand je ne serai plus, à mon tour, qu'un avis de décès et quelques souvenirs pour ma famille et mes amis, qu'arrivera-t-il à tout ce que j'ai conservé? Y aura-t-il quelqu'un pour éviter que tout cela tombe dans l'oubli?
Adieu Joseph Costisella.
mardi 2 juillet 2013
Solidarité entre francophones: qu'en sait-on, vraiment?
Quelques jours avant la St-Jean, le quotidien Le Droit avait publié les résultats d'un sondage de l'Association d'études canadiennes (AEC), portant sur la perception du déclin du français et/ou de l'anglais au Québec, ainsi que sur l'intérêt porté par les Québécois aux minorités francophones des autres provinces et sa contrepartie, l'intérêt porté par le reste du Canada (RDC) à la communauté anglophone du Québec.
La découverte que la « solidarité » était supérieure entre francophones semble en avoir surpris quelques-uns. Le sondage effectué auprès de 2000 répondants révélait en effet que sur une échelle de 0 à 10 (0 signifiant aucun intérêt, 10 indiquant « très intéressé »), 62% des francophones du Québec avaient coché les cases entre 7 et 10 pour quantifier leur degré d'intérêt envers les minorités de langue française ailleurs au pays. Chez les anglophones du RDC, seulement 39,9% des répondants manifestaient un intérêt semblable pour les Anglo-Québécois.
« J'avoue que je suis un peu étonnée, Qu'il y ait 62% des francophones du Québec qui s'intéressent à nos communautés alors que nous avons parfois l'impression que la plupart ne savent pas que nous existons, c'est bon signe », avait déclaré Marie-France Kenney, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada. Une déclaration un tout petit peu surprenante, puisque même si les Québécois connaissent peu la situation des minorités francophones, l'intérêt pour les Canadiens français hors Québec et les Acadiens a toujours existé depuis les années suivant la Confédération (à partir de 1871, avec l'abolition des écoles acadiennes) et ne s'est jamais démenti.
Par ailleurs, les explications du directeur général de l'AEC, Jack Jedwab, me paraissent comme étant de la pure spéculation, à moins qu'il n'ait en mains des données plus complètes qui ne sont pas dévoilées dans son sondage. Selon lui, cet intérêt plus fort pour les francophones hors Québec se développe depuis seulement une dizaine d'années, peut-être en raison de l'absence de crise constitutionnelle et d'une diminution des affrontements entre provinces. La migration de milliers de Québécois vers d'autres provinces, l'Alberta notamment, serait aussi un facteur pertinent dans cette « solidarité » accrue... Sans douter des bonnes intentions de M. Jedwab, ces déclarations m'apparaissent éminemment contestables.
Dans une lettre récente (18 juin 2013) au Devoir, le chanteur cajun Zachary Richard écrivait ceci : « La francophonie nord-américaine et la relation entre le Québec et les communautés francophones hors Québec sont des questions complexes et fort nuancées qui ne se décodent pas dans l'espace d'une brève entrevue (Zachary aurait pu ajouter : ... ni d'un bref sondage). Je vous invite donc à publier une série sur la francophonie nord-américaine dans toute son ampleur, pour que vos lecteurs puissent mieux comprendre la vie de ces 33 millions de parleurs et de parleuses de français semés comme des tache de rousseur sur la face de ce continent et avec qui les Québécois partagent plus qu'ils n'imaginent. »
Le chanteur louisianais met ici le doigt sur deux problèmes d'envergure : la réelle complexité des situations vécues par les communautés francophones hors Québec et l'intérêt faible (pour ne pas dire nul) de la presse québécoise (et canadienne) pour ces communautés. Sauf quelques crises ponctuelles, celle de l'hôpital Montfort, à Ottawa, étant la plus récente - de 1997 à 2001 - l'information diffusée sur la francophonie canadienne hors Québec fait pitié. À l'exception du Droit et des réseaux régionaux de Radio-Canada, les médias quotidiens ont d'autres chats à fouetter...
Ce qu'il faut donc retenir, au départ, c'est que les francophones du Québec ne savent pas grand-chose de la réalité quotidienne de leurs « cousins » hors Québec et que, vice versa, l'information que les francophones hors Québec (surtout hors Acadie du Nouveau-Brunswick et à l'extérieur de l'Est ontarien) obtiennent sur le Québec leur parvient surtout de médias anglo-canadiens tout aussi mal informés. Alors comment peut-on se former une opinion ou un réel intérêt quand le savoir nécessaire à la formation de ces opinions ou intérêts fait défaut?
Cela ne signifie pas, toutefois, absence d'intérêt ou de solidarité. La plupart des francophones hors Québec non acadiens (à l'exception des nouvelles vagues d'immigrants) proviennent de familles ayant quitté le Québec, certaines depuis des générations, d'autres récemment. Il existe donc depuis fort longtemps des liens de mémoire, de parenté et de culture qui restent bien vivants. La « grande famille » se rassemble peut-être assez rarement, mais on l'a vu à l'occasion serrer les rangs : lors de la pendaison de Riel, lors du Règlement XVII en Ontario, ainsi lors de que l'affaire Montfort.
Cela ne signifie pas l'absence de heurts ou de conflits politiques. Les Québécois francophones étant majoritaires sur leur territoire et ayant toujours eu un sentiment national axé sur les rives du Saint-Laurent, l'éclosion du mouvement indépendantiste des années 1960 était un prolongement naturel des mouvements d'autonomie provinciale des époques précédentes. La soi-disant rupture entre les Québécois souverainistes et les francophones hors Québec, vers la fin des années 1960, était bien plus une brèche dans la solidarité historique qu'une transformation fondamentale du sentiment national.
Là comme aujourd'hui, l'information disponible était fragmentaire et réservée aux élites, aux militants et aux chercheurs qui s'intéressaient de près à la situation des Acadiens et Canadiens français. Le grand public québécois ignorait à peu près tout du vécu des Franco-Ontariens, des Franco-Manitobains et des autres. Même à l'intérieur de ces groupes, les communautés se connaissaient mal ou peu. L'Ontario, c'est grand comme un pays : que savaient les Franco-Ontariens d'Ottawa de leurs compatriotes de Hearst ou de Timmins, dans le Nord ontarien? Peu de choses, en vérité.
Malgré tout, confusément, dans le substrat de la mémoire collective, en dépit des problèmes, les francophones du Québec et des autres provinces ont encore des, parfois, des allures de grande famille. Une grande famille fondée sur la parenté et la culture, faute de pouvoir être assise sur des objectifs politiques communs. Le journaliste Jules-Paul Tardivel, notait en 1899, ayant remarqué la tiédeur des francophones du Québec à l'endroit des fêtes du Dominion Day (1er juillet) :
« Pour les Canadiens français, la vraie patrie c'est toujours la province de Québec. Si nous sommes attachés aux groupes français des autres provinces, c'est par les vieux liens du sang, de la langue et des traditions; non point par le lien politique créé en 1867. Nous nous intéressons à nos frères de l'Est et de l'Ouest parce qu'ils sont nos frères; non parce qu'ils sont nos concitoyens. »
Ces distinctions entre solidarités politiques et culturelles font également partie de la complexité des liens entre les Québécois francophones et les minorités canadiennes-françaises et acadienne. Peut-être le temps est-il venu enfin de combler les trous béants de mémoire et de connaissances qui nuisent à la compréhension des uns et des autres. L'effort d'effectuer un sondage là-dessus est déjà intéressant. Mais ce n'est qu'un tout petit pas.
La découverte que la « solidarité » était supérieure entre francophones semble en avoir surpris quelques-uns. Le sondage effectué auprès de 2000 répondants révélait en effet que sur une échelle de 0 à 10 (0 signifiant aucun intérêt, 10 indiquant « très intéressé »), 62% des francophones du Québec avaient coché les cases entre 7 et 10 pour quantifier leur degré d'intérêt envers les minorités de langue française ailleurs au pays. Chez les anglophones du RDC, seulement 39,9% des répondants manifestaient un intérêt semblable pour les Anglo-Québécois.
« J'avoue que je suis un peu étonnée, Qu'il y ait 62% des francophones du Québec qui s'intéressent à nos communautés alors que nous avons parfois l'impression que la plupart ne savent pas que nous existons, c'est bon signe », avait déclaré Marie-France Kenney, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada. Une déclaration un tout petit peu surprenante, puisque même si les Québécois connaissent peu la situation des minorités francophones, l'intérêt pour les Canadiens français hors Québec et les Acadiens a toujours existé depuis les années suivant la Confédération (à partir de 1871, avec l'abolition des écoles acadiennes) et ne s'est jamais démenti.
Par ailleurs, les explications du directeur général de l'AEC, Jack Jedwab, me paraissent comme étant de la pure spéculation, à moins qu'il n'ait en mains des données plus complètes qui ne sont pas dévoilées dans son sondage. Selon lui, cet intérêt plus fort pour les francophones hors Québec se développe depuis seulement une dizaine d'années, peut-être en raison de l'absence de crise constitutionnelle et d'une diminution des affrontements entre provinces. La migration de milliers de Québécois vers d'autres provinces, l'Alberta notamment, serait aussi un facteur pertinent dans cette « solidarité » accrue... Sans douter des bonnes intentions de M. Jedwab, ces déclarations m'apparaissent éminemment contestables.
Dans une lettre récente (18 juin 2013) au Devoir, le chanteur cajun Zachary Richard écrivait ceci : « La francophonie nord-américaine et la relation entre le Québec et les communautés francophones hors Québec sont des questions complexes et fort nuancées qui ne se décodent pas dans l'espace d'une brève entrevue (Zachary aurait pu ajouter : ... ni d'un bref sondage). Je vous invite donc à publier une série sur la francophonie nord-américaine dans toute son ampleur, pour que vos lecteurs puissent mieux comprendre la vie de ces 33 millions de parleurs et de parleuses de français semés comme des tache de rousseur sur la face de ce continent et avec qui les Québécois partagent plus qu'ils n'imaginent. »
Le chanteur louisianais met ici le doigt sur deux problèmes d'envergure : la réelle complexité des situations vécues par les communautés francophones hors Québec et l'intérêt faible (pour ne pas dire nul) de la presse québécoise (et canadienne) pour ces communautés. Sauf quelques crises ponctuelles, celle de l'hôpital Montfort, à Ottawa, étant la plus récente - de 1997 à 2001 - l'information diffusée sur la francophonie canadienne hors Québec fait pitié. À l'exception du Droit et des réseaux régionaux de Radio-Canada, les médias quotidiens ont d'autres chats à fouetter...
Ce qu'il faut donc retenir, au départ, c'est que les francophones du Québec ne savent pas grand-chose de la réalité quotidienne de leurs « cousins » hors Québec et que, vice versa, l'information que les francophones hors Québec (surtout hors Acadie du Nouveau-Brunswick et à l'extérieur de l'Est ontarien) obtiennent sur le Québec leur parvient surtout de médias anglo-canadiens tout aussi mal informés. Alors comment peut-on se former une opinion ou un réel intérêt quand le savoir nécessaire à la formation de ces opinions ou intérêts fait défaut?
Cela ne signifie pas, toutefois, absence d'intérêt ou de solidarité. La plupart des francophones hors Québec non acadiens (à l'exception des nouvelles vagues d'immigrants) proviennent de familles ayant quitté le Québec, certaines depuis des générations, d'autres récemment. Il existe donc depuis fort longtemps des liens de mémoire, de parenté et de culture qui restent bien vivants. La « grande famille » se rassemble peut-être assez rarement, mais on l'a vu à l'occasion serrer les rangs : lors de la pendaison de Riel, lors du Règlement XVII en Ontario, ainsi lors de que l'affaire Montfort.
Cela ne signifie pas l'absence de heurts ou de conflits politiques. Les Québécois francophones étant majoritaires sur leur territoire et ayant toujours eu un sentiment national axé sur les rives du Saint-Laurent, l'éclosion du mouvement indépendantiste des années 1960 était un prolongement naturel des mouvements d'autonomie provinciale des époques précédentes. La soi-disant rupture entre les Québécois souverainistes et les francophones hors Québec, vers la fin des années 1960, était bien plus une brèche dans la solidarité historique qu'une transformation fondamentale du sentiment national.
Là comme aujourd'hui, l'information disponible était fragmentaire et réservée aux élites, aux militants et aux chercheurs qui s'intéressaient de près à la situation des Acadiens et Canadiens français. Le grand public québécois ignorait à peu près tout du vécu des Franco-Ontariens, des Franco-Manitobains et des autres. Même à l'intérieur de ces groupes, les communautés se connaissaient mal ou peu. L'Ontario, c'est grand comme un pays : que savaient les Franco-Ontariens d'Ottawa de leurs compatriotes de Hearst ou de Timmins, dans le Nord ontarien? Peu de choses, en vérité.
Malgré tout, confusément, dans le substrat de la mémoire collective, en dépit des problèmes, les francophones du Québec et des autres provinces ont encore des, parfois, des allures de grande famille. Une grande famille fondée sur la parenté et la culture, faute de pouvoir être assise sur des objectifs politiques communs. Le journaliste Jules-Paul Tardivel, notait en 1899, ayant remarqué la tiédeur des francophones du Québec à l'endroit des fêtes du Dominion Day (1er juillet) :
« Pour les Canadiens français, la vraie patrie c'est toujours la province de Québec. Si nous sommes attachés aux groupes français des autres provinces, c'est par les vieux liens du sang, de la langue et des traditions; non point par le lien politique créé en 1867. Nous nous intéressons à nos frères de l'Est et de l'Ouest parce qu'ils sont nos frères; non parce qu'ils sont nos concitoyens. »
Ces distinctions entre solidarités politiques et culturelles font également partie de la complexité des liens entre les Québécois francophones et les minorités canadiennes-françaises et acadienne. Peut-être le temps est-il venu enfin de combler les trous béants de mémoire et de connaissances qui nuisent à la compréhension des uns et des autres. L'effort d'effectuer un sondage là-dessus est déjà intéressant. Mais ce n'est qu'un tout petit pas.
Inscription à :
Articles (Atom)